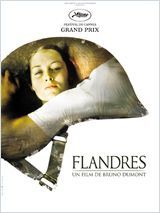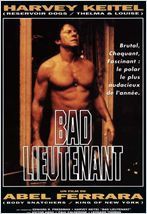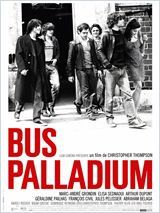Voici un petit court-métrage sans prétention et tout à fait intéressant, bel hommage au temps du muet, entre cinéma expressionniste et évocation des grandes figures de la comédie. Avec des jeunes
gens plein de talent !


Mais où sont donc passés la patte et le talent de Tim Burton ? A la vue de cette débauche (certes très « friquée ») d’effets spéciaux et de guimauve aux couleurs criardes, on est en effet en
droit de se le demander ! Son adaptation d’« Alice in Wonderland » semble pour le coup plus proche d’un « Alice et Johnny Depp in Disneyland » : les aventures s’enchaînent à toute vitesse sans
véritable relief (pourtant en 3D !) et sans que l’on ne retienne rien, sinon d’avoir été très secoué, une fois le tour de manège terminé… C’est plein de vertiges et de surcharges graphiques
inutiles, mais on peine vraiment à y déceler la moindre trace d’émotion ou de fantaisie ! L’esbroufe incessante et vulgaire semble constamment privilégiée à l’intelligence poétique… Pour un film
d’un tel cinéaste tiré d’un livre pareil, c’est quand même un comble ! Non seulement Burton s’efface devant un projet de grosse machine impersonnelle produite par Disney, dans laquelle son style
décalé voire carrément sombre (à la « Edward aux mains d’argent » ou à la « Sweeney Todd » par exemple) ne ressort quasiment jamais, mais il se permet en plus des libertés pas très inspirées par
rapport à l’œuvre de Lewis Carroll, qui perd pour le coup en surprises et en absurdités… Tous les petits plaisirs pervers et pédophiles de la lecture d’« Alice au pays des merveilles » semblent
par ailleurs annihilés, la relecture filmique ayant bien fait son travail d’épuration et de stérilisation, rendant le tout désespérément ennuyeux et vain… On attendait peut-être trop de cette
rencontre excitante de deux artistes torturés et dégénérés, mais un aussi fade résultat est bien triste à voir, tout de même !
Mise en perspective :
- L’expérience 3D : révolution esthétique ou gadget sans relief
?
- Le drôle de Noël de Scrooge 3D, de Robert Zemeckis (Etats-Unis,
2009)
- Amityville 3-D, de Richard Fleischer (Etats-Unis, 1983)


Existe-t-il un lien cinématographique entre Tarzan et King Kong, deux
personnages mythiques ayant eu des destins assez proches : deux « bêtes » (ou demi-bête pour Tarzan) tombées amoureuses d’une humaine… Eh bien je vous mets cette semaine au défi de trouver ce
lien ! N’oubliez pas que Tarzan n’a pas eu qu’un seul interprète au cinéma… et que « King Kong » a bénéficié de plusieurs versions depuis celle de 1933 !
La règle du jeu des 7 degrés de séparation est faite pour vous aider si vous débutez…
Adèle R. gagne son 2e point grâce à Catherine et Irène Jacob ! Mais que font les autres ?
Vont-ils la laisser gagner dès cette semaine ? Car avec 3 points, Adèle R. pourrait alors déjà choisir son cadeau parmi les DVD suivants :
- « Akoibon » d’Edouard Baer
- « The calling » de Richard Caesar
- « L’étrange créature du lac noir » de Jack Arnold (accompagné
du documentaire "Retour sur le lac noir")
- « Flandres » de Bruno Dumont (dans une superbe édition collector digipack double-DVD,
débordante de bonus passionnants !)
Vous êtes prêt ? C’est donc à vous de jouer maintenant ! A dimanche prochain, 13h13, pour les résultats et un nouveau jeu !