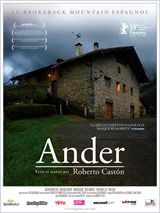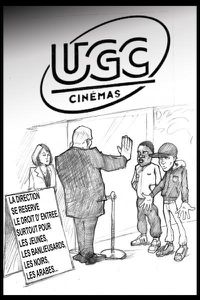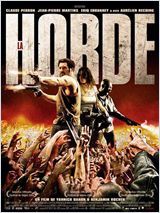Aux hommes qui ne seront jamais des fils
Aux hommes qui ne seront jamais des fils
Aux fils qui cherchent des pères
Aux pères qui ne connaissent plus leurs fils
A mes enfants à venir dont je peux enfin rêver Bernard Bellefroid achève ainsi son premier film de fiction, sur ces mots entre douleur et poésie, comme si "La régate" avait été pour lui une forme de thérapie... Il l'explique d'ailleurs très
bien lui-même : "Je connais bien Alexandre, mon personnage principal. J'ai longtemps regardé le monde avec ses yeux. Comme lui, j'ai longtemps vécu dans une violence que l'on dit domestique,
cachée. Comme lui, je scrutais les portes pour m'enfuir. Je sursautais à chaque fois qu'on s'approchait de mon visage. A quinze ans, regarder, observer, épier, c'était les moyens de ma survie.
Quinze ans plus tard, regarder est devenu mon métier. Heureusement, les raisons évoluent avec l'âge. A quinze ans, c'était pour se venger. A vingt ans, pour juger. A vingt-cinq ans, pour
comprendre. A trente ans, il était indispensable de raconter combien cette histoire était aussi une histoire d'amour. De l'amour qui s'exprime mal mais de l'amour quand même."
Dans son film, le documentariste-cinéaste présente la relation tumultueuse d'un fils avec son père violent et alcoolique. La relation malsaine qui se tisse entre les deux personnages est montrée
avec une finesse et une acuité assez rare et impressionnante. Le fils reçoit les coups et le père s'acharne parfois presque bestialement, mais les rapports sont plus complexes : un plan séquence
extraordinaire le montre admirablement, alors que le père est complètement saoul couché dans le caniveau et que son fils essaie de l'étouffer pour finalement l'embrasser l'instant d'après... Les
relations affectives sont complexes et Bellefroid le montre avec une force et une rage exceptionnelle ! Dans cette relation difficile, traitée avec un immense respect, les deux acteurs crèvent
l'écran grâce à leur charisme magistral et à leur jeu tout en nuance ! Thierry Hancisse incarne un père pathétique, qui s'accroche à une morale exemplaire à inculquer à son enfant, comme par
exemple ne pas voler, pour mieux oublier sans doute que ce qu'il lui fait subir quotidiennement à Alexandre est une abomination. Quant au jeune Joffrey Verbruggen, entre l'adolescent sombre et le
petit animal blessé, il est ici une pure révélation cinématographique !
Mais le film ne tourne pas qu’autour de cet appartement de promiscuité où se joue le rapport d’amour-haine entre le fils et le père. Il suit surtout l’itinéraire du garçon, qui par sa pratique de
l’aviron parvient à dépasser le climat d’oppression de sa vie en train d’être brisée, sans qu’il n’ose rien faire, rien dire, de peur de perdre sans doute sa dernière famille, ce père violent qu’il
défie sans cesse mais sur qui il n’arrive pas encore à avoir le dessus… C’est pourtant dans son club sportif qu’il semble reconstituer sa propre famille. Il trouve bien sûr une sorte de père de
substitution dans la personne de son entraîneur, toujours derrière lui et prêt à lui apprendre la vie autant que la technique de l’aviron, incarné à l’écran par Sergi Lopez, comme souvent très
bien… En passant de la pratique en solitaire à la collaboration avec son concurrent direct, qu’il déteste, Alexandre apprendra aussi la confrontation à l’autre, la nécessité de la solidarité,
principalement lorsque l’on est littéralement embarqué dans la même galère (c’est là que la métaphore du sport nautique se révèle tout à fait pertinente !), ainsi que l’amitié, puis l’amour à
travers le regard que porte sur lui une jeune fille du club. Il faut voir la fragilité de l’adolescent à l’écran, capable de fondre en larmes, tellement débordé d’émotion à la moindre attention à
son égard, comme au cours de la soirée pendant le stage où ses camarades lui souhaitent modestement son anniversaire, pour comprendre toute la beauté, la grâce et la finesse de ce long métrage ! Il
faut le voir souffrir en silence devant les autres, pour ne pas condamner le père, alternant les regards sombres, quasiment désespérés, et les sourires plus gracieux et enfantins lorsqu’il est avec
ses nouveaux amis, prêt alors à s’oublier… Loin du père, son visage peut passer de la gravité à la plus innocente tendresse en un regard, en un geste ou en un mot.
On pourrait très vite sombrer dans le misérabilisme, mais le film est au contraire une sacrée claque éclairante et visionnaire, dépassant son sujet en le traitant obliquement, loin des clichés et
de la morale appuyée que l'on retrouve la plupart du temps dans ce genre d'histoire. Le réalisateur s’applique par ailleurs à une mise en scène hyper maîtrisée et d’une cohérence galvanisante pour
le spectateur. Le travail sur la photographie, notamment, est incomparable ! Cette délimitation de l’ombre et de la lumière entre les différents espaces du film, principalement entre l’appartement
constamment mal éclairé et le fleuve ensoleillé sur lequel le garçon avironne, est saisissante tout au long de « La régate ». La beauté des visages, lorsque l’eau se reflète sur eux, sublime la
jeunesse ainsi filmée. Et la façon d’exalter les corps à l’écran, toute cette puissance et finalement cette violence contenue en eux, est absolument magnifique. Le corps du garçon, suant sang et
eau pour indéfiniment améliorer ses performances sportives, est suivi par la caméra dans tous ses efforts, avec un véritable élan. L’emploi de la musique, spécialement les morceaux rock, accentue
encore davantage cette dimension de l’effort et de rage contenu qui explose dans le sport.
On pourrait enfin parler de l’ultime plan du film, s’achevant sur un regard caméra indécis mais vraiment poignant du garçon, après qu’il ait regardé sa demi-sœur sur le point de l’éloigner du père
et levé également un œil à la fenêtre de l’appartement-enfer qu’il quitte enfin et d’où le regarde tristement le père, rongé par la culpabilité… Mais ce serait réduire le film à son très haut
pouvoir symbolique. Un pouvoir fondamental et rédempteur dans sa construction et ses articulations, certes, mais loin d’être le seul intérêt de ce film particulièrement riche de cinématographie,
d’intelligence, de réflexions, d’humanité, et probablement de mille autre choses… Un film à voir, nécessairement !