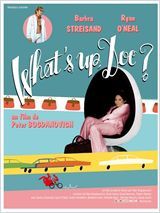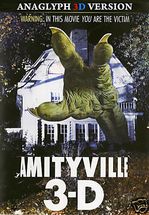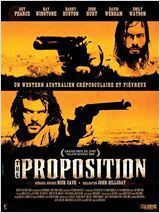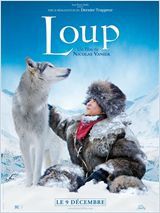Note :

Avouons-le tout de suite : Rec 2 déçoit si on le regarde en pensant au premier
volet. Il faut dire que comme la plupart des suites du genre, le film a les défauts de ce qui faisait la qualité de l’œuvre originale… Ici, l’effet de surprise est bien tari, surtout que le traitement
demeure identique au précédent Rec. Bien sûr, la surenchère aidant, la suite a plus de moyens, donc plus de caméras subjectives (c’est un peu le principe de la mise en scène), plus de points de
vue, plus d’angles et une marge de manœuvre plus grande pour les cinéastes dans la réalisation… Sauf que non seulement la façon dont les choses sont amenées n’est pas forcément très crédible (une
équipe de super policiers arrivent dans l’immeuble juste après la fin du premier film avec un super équipement, avec des super casques équipés de super caméras…), mais il faut bien reconnaître
aussi que ça n’apporte pas forcément grand chose, sinon une plus grande dispersion. Avec plus de moyens, on a aussi l’impression que l’immeuble s’est agrandi, aussi bien en hauteur qu’en largeur,
ce qui est assez curieux quand on y pense : de nouvelles pièces secrètes apparaissent, révélant plein de nouveaux mystères… Et à propos de « mystère » justement, on touche du doigt le principal
problème de cette suite un peu bâclée comme une vulgaire copie, un peu trop scolaire, du premier opus : le fait de ne jamais vraiment savoir ce qui se passe, qui rendait le premier film si
effrayant, est ici remplacé par un déluge d’explications curieuses et pas toujours convaincantes, un peu bavardes aussi, qui font lorgner le film du côté de « L’exorciste »… On suppose que tout le
côté religieux qui apparaît alors est lié aux origines espagnoles des réalisateurs et de la production ?
Un peu trop explicatif donc, le film est également curieusement construit. Outre l’équipe de policiers, trois ados pénètrent pour s’amuser et pour filmer des « trucs de oufs » dans l’immeuble
démoniaque, mais cette seconde histoire ne nous est montrée qu’après la première, alors qu’elle se déroule en même temps. On a du coup l’impression de deux films mis bout à bout, avec deux
gradations dans l’horreur comme savent le faire les films d’épouvante. Bon, ce n’est pas forcément gênant dramatiquement, dans la mesure où le film demeure plutôt efficace et que les cinéastes sont
toujours aussi malins pour nous terrifier, avec des effets visuels ou sonores parfois assez recherchés ou aux limites de l’impressionnisme… Intéressant ou impressionnant, finalement ! Et même si on
nous tire quelques grosses ficelles pour faire parvenir le métrage à 85 bonnes minutes (la réapparition suspecte de la journaliste du premier film, par exemple, nous laisse entrevoir le dénouement
gros comme une maison !), on ne va tout de même pas bouder notre plaisir, parce que oui, vraiment, le procédé narratif et stylistique de Rec, même si on le connaissait déjà, demeure rudement
efficace et excitant… On a moins peur, certes, mais on jubile encore pas mal !
A revoir : Rec