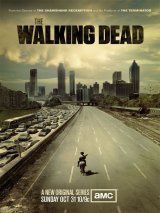Orange mécanique, de Stanley Kubrick (Grande-Bretagne, Etats-Unis, 1971)
Note :




Adapté du génial roman d'Anthony Burgess, « Orange mécanique » de Stanley Kubrick est un film culte et puissant ! L’image de l’acteur Malcolm McDowell incarnant le personnage d’Alex est devenue
mythique dans l’imaginaire de tout cinéphile digne de ce nom… Situé dans un futur proche (du début des années 70 donc !), le film s’aventure d’une certaine façon sur le terrain de l’anticipation
: si le « décorum » et l’esthétique (décors baroques, costumes grotesques, voiture du « futur »…) peuvent paraître très kitsch aujourd’hui (mais un kitsch qui semble parfaitement assumé…
d’ailleurs, ne l’était-il pas déjà pleinement en son temps ?), la vision du futur permet essentiellement de jeter un regard sombre et pessimiste sur la société de l’époque, mais plus largement
aussi sur tous les modèles de sociétés humaines ! La noirceur de l’ensemble passe d’abord par les errances nocturnes crues et « ultraviolentes » d’Alex et de ses « droogs » (ses « amis » en «
Nadsat », le dialecte que parlent les jeunes dans ce monde « inventé »), qui se battent avec tous ceux qu’ils trouvent sur leur passage ou qui violent sans état d’âme des femmes directement à
leur domicile, où les gens se pensent soi-disant en « sécurité »… Si les scènes de violence s’enchaînent à l’écran, souvent très théâtralisées, le côté sombre du film vient aussi de l’atmosphère
générale (les lieux, la nuit, les éclairages…) ou encore des sonorités étranges qui résonnent régulièrement (sons déformés au vocodeur ou au synthétiseur, instruments encore balbutiants et
expérimentaux à l’époque).
Bizarrement, malgré un ensemble bien sombre, « Orange mécanique » peut aussi être vu comme une pure comédie, aux accents souvent burlesques : ce mélange de perceptions signant bien sûr toute la
subtilité du génie du cinéaste ! Rien que le langage parlé par les personnages est déjà assez tordant (un argot anglo-russe imaginé par Burgess dans le roman), mais les présences d’humour sont
fort nombreuses dans le long métrage. On a déjà parlé des décors très kitsch : on pense au Milk bar Korova, où Alex et ses potes prennent du lait enrichi de drogues diverses à des fontaines qui
ne sont rien d’autres que les seins de mannequins féminins nus, ou encore à ce magasin de disques très disco et « flower power », où l’on aperçoit d’ailleurs dans les bacs un vinyle de la bande
originale du film « 2001, l’odyssée de l’espace », précédent opus de Kubrick… Quand le génie s’amuse ! Une dimension presque grotesque et diverses exagérations poussées à l’excès créent en outre
une réaction comique proche de l’absurde : une partouse passée en accéléré (avec deux « suceuses » de glaces en forme de bites qu’Alex a rencontré chez le disquaire), un meurtre à coups de
phallus sculpté géant dans ta gueule (œuvre de madame Kubrick en personne, soit dit en passant !), ou encore cette séquence ubuesque de viol commis par un Alex chantant à tue-tête le standard de
comédie musicale « Chantons sous la pluie » ! On rit aussi de voir l’acteur adulte dans la peau d’un adolescent vivant chez ses parents (dont une mère aux cheveux bleus assez excentrique), choix
dramatique impliquant un décalage évident… La conversion religieuse d’Alex en prison vaut quant à elle son pesant de Moloko : il pense au Christ, certes, mais plutôt du point de vue du romain en
train de le fouetter pendant qu’il porte sa croix. On retient encore ces réorchestrations curieuses de grands classiques au synthé (à commencer par le grand Ludwig van… Beethoven). Sans oublier
cette étonnante succession de hasards à la fin, lorsque Alex, rendu inoffensif, tombe nez à nez avec tous ceux qu’il avait blessé auparavant, nous plongeant alors en pleine bouffonnerie : le
personnage se fait ainsi humilier à tout de rôle par un clochard qu’il avait violenté, ses anciens droogs délinquants devenus policiers (ça en dit long sur l’illusion sécuritaire que cherchent
encore à nous vendre les politiques aujourd’hui !), puis par un homme handicapé qui n’est autre que le mari de la femme qu’il avait violée, morte depuis. Cette scène introduit d’ailleurs une
répétition comique, Alex sonnant à la porte de la maison et un mouvement de caméra identique à la première confrontation des personnages montrant à l’intérieur l’homme en train de taper à la
machine puis un type bodybuildé qui lui sert d’aide à domicile étrangement sexué, qui remplace sa femme dans la séquence à laquelle il est ici fait écho…
Ainsi, la comédie permet probablement à Kubrick d’atténuer en partie la profonde noirceur de son film, qui propose pourtant une représentation hyper sombre et glauque de la civilisation… A
première vue, « Orange mécanique » est avant tout une réflexion sur le libre arbitre, le personnage d’Alex subissant un traitement inhumain (la méthode « Ludovico ») qui permet de le rendre
inoffensif et incapable de violence, afin de pouvoir le relâcher dans le monde, sans la moindre défense. En prison, le prêtre le met d’ailleurs en garde sur cette option, en lui expliquant que
"le bien vient du dedans, qu'il est le résultat d'un choix : l'homme qui ne peut plus faire ce choix n'est plus un homme". La société deviendrait donc amorale en condamnant les criminels non pas
au bien, mais à l’impossibilité de faire le mal… Une façon hypocrite, en somme, de se débarrasser des problèmes et de faire « marcher droit » les délinquants. Sauf que cette explication serait
trop simple et que Kubrick a un jour déclaré qu’« Alex représente l'homme dans son état naturel ; lorsqu'on le « traite », cela correspond au processus même de la civilisation». Les termes de
bien et de mal disparaissent alors totalement, et c’est en cela que le film est puissamment ambigu et bien plus complexe qu’il n’en a l’air. Il demeure également très noir et présente l’image
d’une humanité coincée par ce qu’elle croit être son « progrès ». Si le bien et le mal sont relatifs, alors les politiques n’ont plus qu’à imposer les « normes » (voilà ce qui est bien, voilà ce
qui est mal) et à conformer chaque citoyen à ces modèles purement culturels. "L'opinion publique est mouvante par nature", déclare cyniquement un ministre à la fin du film. Le principe d’humanité
ou de moralité n’est donc finalement qu’une vue de l’esprit, et l’idée d’« homme civilisé » ne serait rien d’autre qu’un homme programmé par un certain nombre de valeurs déterminées : le titre du
film prend là tout son sens, le terme « orange » signifiant « homme » en Nadsat… Voilà ce que nous montre cruellement et magistralement Kubrick : un « homme mécanique » comme symbole de
l’humanité !
Mise en perspective :
- Exposition : Kubrick à brac ! (à la Cinémathèque française)
- Les sentiers de la gloire, de Stanley Kubrick
- Lolita, de Stanley Kubrick
- Shining, de Stanley Kubrick
- Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick
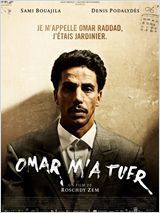
![]()
![]()