
Note :![]()
![]()

Note :![]()
Prétendument adapté d’une nouvelle de H.P. Lovecraft (en réalité, il est fait une simple allusion au texte « Les rats dans les murs » au détour d’une réplique), « Re-Animator 2 » ne se distingue
pas par une très grande subtilité ni par une délicate finesse… Suite directe d’un premier film signé Stuart Gordon (quand même !), il propose d’aller encore plus loin que son prédécesseur dans la
surenchère morbide, en imaginant une parodie étonnante de « La fiancée de Frankenstein » : non contents de « réanimer » les morts, les deux savants fous iront ainsi jusqu’à « recréer » une
nouvelle fiancée pour l’un d’eux à partir de divers restes humains…
Passons d’abord sur la forme, qui souffre hélas d’une mise en scène souvent grossière et d’un montage chaotique, qui peut parfois perdre son spectateur… Le scénario n’est pas non plus très fourni
et tourne assez vite à vide, laissant le film prendre un tour quelque peu répétitif au bout d’un certain temps. Voilà pour les petits soucis, qui ne font pas de « La fiancée de Re-Animator » une
brillante référence de l’horreur… Reste cependant que le maître de l’horreur Brian Yuzna sait faire preuve de beaucoup d’inventivité dans la morbidité à l’œuvre dans son film ! On est en effet
très vite emballé par les multiples trouvailles que le docteur Herbert West parvient à nous proposer dans sa « folie réanimatrice » : tête volante grâce à une greffe d’ailes de chauve-souris, un
bras et une jambe collés ensembles, un œil monté sur quatre doigts (ce qui lui permet de courir partout), un chien dont l’une des pattes est remplacée par une main humaine… et surtout le
chef-d’œuvre suprême du docteur, réalisé pour son assistant : le cœur de sa bien aimée défunte placé à l’intérieur d’un nouveau corps recomposé de multiples morceaux de femmes diverses ! Le tout
fait un peu inventaire ou énumération à la Prévert version gore, mais la diversification et l’originalité dans chaque détail de ces monstrueux assemblages fait quand même rudement plaisir à
voir…
Soulignons enfin le ton largement parodique de l’ensemble, qui permet à Brian Yuzna de se délecter d’humour noir et de délires macabres des plus réjouissants ! Entre les inventions tordues du
savant fou, le rire démoniaque d’une tête volante et les allusions appuyées à l’homosexualité refoulée du docteur à l’égard de son assistant (dans des séquences mélodramatiques juste énormissimes
!), on se retrouve clairement dans le délire potache et le comique burlesque ! Ainsi partagé entre horreur et grand guignol, entre rire et dégoût, on passe finalement un excellent moment devant
un film néanmoins réservé aux amateurs du genre…
Si la vidéo ne s'affiche pas correctement ci-dessus, cliquez ici pour la voir
En 2008, Bruno Aveillan signe deux vidéoclips pour deux chansons de Mylène Farmer : "Dégénération" et "Si j'avais au moins", issues de son nouvel album "Point de suture". Les deux clips mis bout
à bout forment en réalité un court métrage d'une quinzaine de minutes, intitulé "The Farmer Project" et malheureusement diffusé de façon très confidentielle à l'époque... Je vous propose de
découvrir ou redécouvrir cette petite merveille audiovisuelle, dans laquelle Sainte Mylène descend sur Terre pour répandre l'amour parmi les hommes (qui en manquent cruellement) et pour sauver
tous les petits animaux torturés par les vilains hommes ! Ou ou wa ou, ou wa ou...

Note :![]()
![]()
Adapté d’un roman de Henry De Vere Stacpoole et remake d’un film beaucoup plus prude de 1949, vague et lointaine évocation de « Paul et Virginie » de Bernardin de Saint-Pierre, ce « Lagon bleu »
met en scène deux enfants qui grandissent seuls sur une île déserte à la suite d’un naufrage. Sans pudeur et avec une distrayante innocence, ils vont nus et découvrent peu à peu l’amour, le sexe
et la reproduction au sein d’une nature apparemment généreuse et abondante, qui pourvoie sans beaucoup d’efforts à tous leurs besoins quotidiens… Le sous-texte crétino-chrétien et quasi biblique
se laisse assez vite sentir : les deux jeunes gens ressemblent à Adam et Eve dans le jardin d’Eden, la femme apparaît très vite comme tentatrice (les fruits rouges interdits qu’elle veut manger
d’emblée, sa façon de regarder le garçon pleine de désirs pour lui alors que lui ne pense pas encore à mal, ses idées de ne pas respecter la Loi en allant par exemple de l’autre côté de l’île…)
et elle finira punie en accouchant dans la douleur, bien entendu ! Ce n’est certes pas très fin, l’ensemble n’est pas non plus très consistant, mais le film demeure plein de fraîcheur et offre à
nos regards songeurs de bien beaux décors idylliques et les jolis corps jeunes et dénudés de Brooke Shields et Christopher Atkins…

Note :![]()
![]()
La trame de ce moyen métrage de la franco-sénégalaise Dyana Gaye est aussi légère que pertinente et bien trouvée ! A Dakar, un taxi-brousse attend d’avoir ses sept passagers pour pouvoir partir
en direction de Saint-Louis. Les voyageurs s’impatientant, le taxi partira finalement avec six passagers, et Antoine, jeune étudiant français venu faire des recherches pour ses études, les
rejoindra plus tard en tant que septième passager… Rien que le double sens du titre est en soi savoureux : le taxi-brousse fait bien sûr office de « transport en commun » en Afrique, et l’article
« un » placé devant montre bien que le petit groupe de personnages vont se réunir tous ensemble pour accomplir ce voyage. Au fil de la route, de discussions en incidents, ils vont apprendre à se
connaître et à évoquer leur « tranche de vie » respective, en d’autres termes le pourquoi de leur présence dans ce taxi qui les mène à Saint-Louis… L’introduction de nombreuses séquences dansées
et chantées viendront bien sûr pimenter ce « road-movie » tout à fait unique en son genre, ajoutant ainsi encore un peu au « transport ». Malgré une faiblesse de moyens assez visible et quelques
approximations dans les chorégraphies ou la mise en scène, on est très vite emballé par la fraîcheur et la spontanéité qui se dégage de ce film tout à fait aimable et enthousiasmant !
Etonnamment, la partition musicale s’oriente plus vers le classicisme des comédies musicales de l’âge d’or hollywoodien que vers le folklore africain à base de tam-tam ou de djembé, et c’est bien
sûr tout à son honneur : on échappe ainsi autant à la facilité qu’à la caricature misérabiliste… Les chansons peuvent aussi bien évoquer la vie courante (l’attente du dernier passager au début,
la vie d’un salon de coiffure…) que parler d’amour, bien sûr ! (un jeune homme fait le voyage pour faire une surprise à sa fiancée, une idylle semble naître entre l’étudiant français et une jeune
coiffeuse sénégalaise…) En cela, dans cette confrontation entre le monde quotidien et celui du rêve, entre le prosaïque et le poétique, on pense très souvent au cinéma de Jacques Demy, à qui « Un
transport en commun » semble vouloir rendre hommage à plusieurs reprises. C’est particulièrement évident dans certaines envolées toutes symphoniques, que l’on croirait inspirées par la grâce de
Michel Legrand ! Le film s’avère d’autant plus réussi et audacieux qu’il mêle à cette enchantement lyrique tout un contexte social et politique, à travers quelques saillies contre les pathétiques
discours d’une France compatissante et post-colonialiste, ou contre la misère du continent africain… Un très beau film, autant divertissant que salvateur !

Note :![]()
![]()
Date de sortie indéterminée
Le film de Florin Serban se situe au croisement de deux mouvances actuelles : d’une part le « revival » du film carcéral (initié par « Un prophète », poursuivi par « Dog pound » ou « Cellule 211 »), et d’autre part la nouvelle vague du cinéma roumain, dont on n’arrête pas
de rappeler le foisonnement depuis la palme d’or de Cristian Mungiu (« 4 mois, 3 semaines, 2 jours »). Il peut d’ailleurs recevoir les félicitations des deux tendances, proposant à la fois
un très beau travail et une certaine originalité… Un Ours d’argent à Berlin lui a en outre déjà été attribué !
« If I want to whistle, I Whistle » s’avère d’abord une critique importante d’une Roumanie qui a bien du mal à sortir de sa pauvreté, malgré son entrée dans l’Europe. L’obligation de nombreux
parents d’abandonner leurs enfants pour gagner de l’argent en allant travailler à l’étranger est stigmatisée à travers le personnage de la mère de Silviu, qui se retrouve alors en prison, très
certainement pour avoir été ainsi livré à lui-même trop longtemps… Le film propose également un portrait plutôt sévère des prisons pour mineurs roumaines, où les détenus semblent souvent laissés
dans des situations collectives misérables et plutôt tendues, et sont emmenés dans les champs pour travailler… On n’est du coup pas très loin des travaux forcés d’antan, sans que le rendu ne soit
trop excessif, bien au contraire !
Le scénario signé Catalin Mitulescu est ensuite une vraie petite merveille, bien mené et assez finement écrit. Le découpage de l’histoire permet une présentation des lieux de la prison et de la
situation de Silviu assez longue et complète, laissant une dernière partie plus courte pour l’explosion psychologique et physique du personnage : l’équilibre qui aurait pu être casse-gueule se
révèle finalement tout à fait adéquat. Silviu est sur le point de terminer son séjour carcéral quand il apprend que sa mère est de retour et risque de faire subir à son jeune frère la même chose
qu’à lui : du coup il va tout faire pour s’assurer de retrouver son frère à sa sortie, quitte à mettre en péril son imminente libération… Le personnage, très bien interprété par le débutant
George Pistireanu, est à la fois dur (avec les autres) et doux (à l’intérieur), ce qui le rend très touchant et attachant. La mise en scène, qui le suit de près avec de nombreux passages « caméra
à l’épaule », contribue à ce très bel effet empathique…
A travers ce garçon pétri de bouillonnements et de paradoxes intérieurs, « If I want to whistle, I Whistle » livre une vraie réflexion sur la liberté. Dans un univers où les détenus semblent
étrangement assez libres de leurs mouvements, pouvant notamment se déplacer d’un baraquement à un autre, aller et venir dans l’espace visiblement avec une certaine aisance, c’est pourtant
lorsqu’il s’enfermera et se barricadera dans un bâtiment que Silviu se sentira le plus libre, à pouvoir menacer et exiger des autres ce qu’il veut ! C’est pourtant en essayant de gagner une
certaine liberté qu’il renoncera pourtant à sa libération, probablement perdu pour un certain temps après ses agissements violents. La séquence ultime, qui lui permet de fuir un instant dans le
monde extérieur (et soi-disant « libre ») est un très beau moment : il choisit de le passer tranquillement à boire un café avec une jeune fille qu’il a pris en otage… Il aurait pu abuser d’elle
comme une bête, mais il n’aspire finalement qu’à un peu plus d’humanité : subtil et poétique ! Il retournera enfin sur la route, direction la prison, pour se faire arrêter sans résistance, et se
résigner à son retour en enfer…
Mise en perspective :
- Le Festival Paris cinéma 2010 vu par Phil Siné, Part I

Note :![]()
Voici un très beau film sur la jeunesse d’aujourd’hui. On y suit l’itinéraire de Julie Bataille, 23 ans, célibataire, études supérieures de lettres et de communication, à la recherche d’un
premier emploi. La cinéaste excelle à nous montrer toute la peine du monde et la galère par laquelle un jeune doit passer pour (peut-être) y parvenir : cruauté des entretiens d’embauches, petites
humiliations quotidiennes dans le monde manipulateur de l’entreprise, petits jobs mal payés et inintéressants… etc. Il y a un réalisme social assez pessimiste derrière tout ça, ajouté à une perte
des repères du personnage, qui se laisse aller à « s’oublier » en boîte de nuit ou à coucher avec n’importe qui… jusqu’à ce qu’elle rencontre Ben, un jeune glandeur débrouillard et un peu loubar,
qui lui fera remettre en question le mode de vie que l’on veut lui imposer. Le film quitte alors le milieu urbain oppressant pour partir sur les routes de la « liberté » et s’amuser un peu à la
campagne. Bien sûr, Julie comprendra que la vie facile de Ben cache quelque chose et qu’elle s’apprête peut-être à prendre une voix un peu dangereuse… Le scénario est bien rythmé, les dialogues
sont impeccables et une certaine grâce vient toucher ces jeunes gens. On les regarde évoluer avec compassion, avec tendresse et toujours avec plaisir, car le couple d’acteurs formé par Pio Marmai
et Anaïs Demoustier est tout simplement magnifique, jusqu’à ce dernier plan où on les voit quasi littéralement se baigner dans un monde « d’amour et d’eau fraîche » !
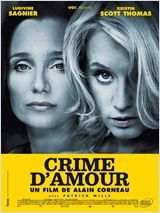
Note :![]()
![]()
Avec "Crime d'amour", Alain Corneau nous plonge dans un univers aseptisé et glacial, celui où évolue comme des requins les cadres d'une puissante multinationale. La mise en scène bénéficie à cet
effet d'une précision photographique absolument exemplaire : chaque plan possède un cadre dans lequel tout semble méticuleusement ordonné, dans lequel tout a l'air lisse et droit, aux angles
directs et perpendiculaires, trop parfait au fond, si parfait que cela rend mal à l'aise et donne froid dans le dos ! Dès la première scène, on est troublé par l'impression d'un milieu trop poli
pour être vrai, et l'on pénètre alors une atmosphère factice, remplie de mensonges et de faux-semblants... On voit deux femmes, l'une travaillant pour l'autre, chacune se renvoyant les sourires
et les compliments avec un air biaisé et pas franchement très franc... Elles jouent, en fait, prétendant s’aimer pour mieux pouvoir tirer ce qu’elles attendent l’une de l’autre.
Ces deux femmes, ce sont Ludivine Sagnier et Kristin Scott Thomas, la première travaillant pour la seconde, la seconde jouant un jeu de plus en plus cruel avec la première, abusant de son pouvoir
jusqu’au harcèlement et à l’humiliation... Elles sont toutes les deux fatalement belles et vénéneuses, et bien entendu extraordinairement brillantes à l'écran ! Kristin Scott Thomas est
excellente dans ce rôle de patronne au sourire ultra-bright constant, qui dissimule à peine un sadisme vampirique et un désir de domination sur les autres. Ludivine Sagnier, elle, cache bien son
jeu : apparemment innocente et victime au début, un renversement inattendu au milieu du film nous la montrera finalement plus radicale que son modèle ! Dans une scène étonnante, qui marque
probablement le moment de basculement dans son esprit, elle apparaît bizarrement presque mauvaise et son interprétation prête à sourire tellement elle pleure sans retenue en semblant s’énerver
contre un ascenseur puis contre sa voiture : sauf qu’en vérité, elle mime dans ce drôle de jeu le ridicule de l’état amoureux, justement ! Même dans la grossièreté des apparences, c’est quand
même toujours la finesse de l’idée qui l’emporte…
Leur jeu de la chatte et de la souris est d’abord palpitant et fascinant. Et lorsqu’au bout d'un moment le jeu s'inverse à travers une scène qu’il convient de taire pour ne pas gâcher
l’effet de surprise, on pénètre alors avec une belle intensité le genre du film noir, quasiment hitchcockien ! Très cinéphile, Corneau revendique d’ailleurs quelques influences, notamment à René
Clément ou à Fritz Lang. Il avoue s’être inspiré de ce dernier pour écrire cette histoire de crime, où le meurtrier se laisse d’abord accuser justement pour mieux pouvoir s’en sortir… Comme le
dit un policier dans une réplique qui ne manque pas de piquant : "Ce n'est pas parce que tout vous accuse que vous n'êtes pas coupable !"
Après la scène fatale, on ressent d’ailleurs comme un flottement : on s’interroge sur les agissements et les motivations de la jeune femme, qui sont pour le moins déconcertants de prime abord…
Puis on comprend progressivement qu’elle vient peut-être de réaliser sous nos yeux le « crime parfait » ! Même si on voit venir la solution bien en amont des révélations du scénario (notamment à
l’aide de petits flash-back en noir et blanc dotés d’un certain humour bienvenu), on reste cependant accroché au film et à ses personnages. Bien sûr, on se doutait bien que le « crime parfait »
n’existe pas, et que même si le crime demeure impuni, un point de détail infime, un oubli apparemment sans conséquence, risque pourtant de transformer très vite la vie d’Isabelle (Ludivine
Sagnier) en enfer… C’est le fameux grain de sable capable de faire vaciller les rouages d’une machine infernale !
Mine de rien, chemin faisant, le cinéaste signe un film rudement bien mené et plein de surprises : tour à tour drôle, cruel ou effrayant, il sait ouvrir les perspectives de son histoire. « En
fait, j’aime beaucoup les films à triple lecture », explique Alain Corneau, « à la première, on s’amuse. A la deuxième, on est sensible au phénomène identitaire, puis à la troisième, arrivent les
phénomènes sociaux… Il y a aussi dans « Crime d'amour » le portrait en creux d’une société, des grandes compagnies multinationales ».
La fin du jeu "Oh my Godzilla" aura finalement été un vrai petit marathon des
participations ! Juste avant minuit samedi soir, Bruce Kraft, le célèbre chroniqueur de La pellicule brûle (LPB pour les intimes...), aura pu
maintenir le suspense de sa présence en compétition jusqu'au dernier moment... Il nous livre une création typiquement Kraftienne, proposant un duel au sommet comme seul le super monstre japonais
sait en livrer :"Godzilla vs Alice" !
Arrivée après la bataille (projet reçu très exactement 5h et 26 min après la fin officielle des participations), Zabeille (qui couche avec
Bruce, sachez-le !) a bien failli se voir éliminer du fabuleux jeu de l'été "Oh mon Gode-zilla !" Cependant, devant les suppliques et les menaces
ignobles que j'ai du essuyer de la part de la butineuse et de son faux-bourdon, j'ai cédé et décidé de vous présenter la merveilleuse carte postale (recto ET verso !) qu'elle a concocté : un
souvenir de vacances à mon intention de la part de Gogodzilla, trop la classe ! Bon, plus sérieusement, c'est bien sûr la qualité du travail et l'effort fourni (Zabeille n'a visiblement pas dormi
durant la nuit de samedi à dimanche !), qui m'ont laissé penser que ce petit chef-d'oeuvre avait pleinement sa place dans la compétition...
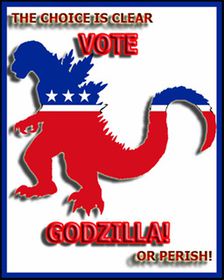
Voilà donc deux mois que le concours de l'été "Oh my Godzilla !" était lancé sur le blog
de Phil Siné. Au final, pas moins de sept valeureux artistes se sont jetés corps et biens dans l'aventure, chacun ou chacune avec son style et avec sa propre vision de la "bête" ! Leurs
participations sont souvent drôles et admirables, et quoiqu'il en soit toujours originales !
S'il ne tenait qu'à moi, je les récompenserais tous, parce qu'ils le méritent ! Seulement voilà : il n'y a que deux cadeaux à attribuer... C'est pourquoi je vous demande à partir de ce jour de
voter afin de départager toutes ces graines de stars !
Pour cela, je vous demanderai d'envoyer par adresse électronique à phil.sine[at]free.fr (remplacez [at] par @) le classement de vos trois oeuvres préférées
avant le vendredi 10 septembre à minuit. Celle que vous situerez au sommet de votre podium gagnera 3 points, celle que vous placerez en second en recevra 2 et la dernière obtiendra un petit
point... Tout le monde peut voter, mais un seul vote par personne sera accepté (même nom, même adresse e-mail : tout abus sera sévèrement sanctionné ! :o) et tout bulletin incomplet ou raturé
sera considéré comme nul !
Afin de ne pas vous décider à la légère, je vous propose de revoir chacune des participations au concours :
- Joueur 2 : Godzilla vs Cachou
- Joueur 3 : Godzilla vs Brodeuse-bazar
- Joueur 6 : Godzilla vs Bruce Kraft
- Joueur 7 : Godzilla vs Zabeille
Les participations au grand concours "Oh my Godzilla !" sont désormais officiellement
closes... Avant de vous inviter à voter pour désigner les deux grands gagnants du concours, je vous propose de découvrir encore la création de Dom,
mystérieusement intitulée : "Le commerce des coeurs pour tous". C'est vrai que même un monstre comme Godzilla devrait avoir droit à l'amour !

Note :![]()
Vous pensiez ne plus jamais revoir les bons gros films d’action complètement décérébrés que l’on nous servait à la louche dans les années 80 et 90, entre les acrobaties de Steven Seagal ou les
grands écarts de Jean-Claude Van Damme ? Eh bien détrompez-vous, malheureux : Stallone remet le couvert cette année avec ses « Expendables », une bande de joyeux adeptes de la salle de sport qui
passent leur temps à se castagner entre eux ! Le seul intérêt du film est de revoir quasiment les mêmes figures que l’on voyait en ce temps là : Sylvester Stallone, Mickey Rourke, Jet Li, Doph
Lundgren… et jusqu’à une brève apparition de Bruce Willis et Arnold « Governator » Schwarzenegger, qui avouons-le demeure assez savoureuse ! Mais ça, c’est deux minutes d’un film de presque deux
heures… Alors c’est vrai que malgré leurs nombreuses rides, ces durs à cuire hyper virils restent super efficaces et en grande forme physique (un peu grâce aux effets spéciaux quand même,
rappelons-le !), toujours prêts à mener des combats musclés, nerveux et chorégraphiés à mort : on jurerait de vraies petites ballerines parfois ! Si vous aimez l’action et seulement l’action,
j’imagine que vous y trouverez votre compte : « Expendables » est un pur produit de pif paf boum badaboum scouiic clic clac vrrt et encore boum ! Mais pour tous les autres, je crains que le film
ne les plonge comme moi dans un abyssal ennui, étant donné la maigreur du scénario, le désordre de l’ensemble (on renonce au bout d’un moment, dans ce déferlement de combats et d’explosions, à
comprendre qui est qui, qui fait quoi, qui tue qui, qui est méchant ou gentil et pourquoi…), ou encore la mise en scène très inégale (quelques tentatives marrantes, mais un ensemble plus que
banal et un montage trop haché : rappelons que ce n’est pas parce que l’action va vite qu’il faut enchaîner une multitude de plans de moins de 2 secondes… sans quoi ça devient vite insupportable
!) Bref, un éprouvant moment de vacuité intellectuelle et de bêtise explosive nourrie à la testostérone dépourvue d’ironie. Il y a bien quelques blagues ici ou là, mais elles relèvent plus du gag
pour gros bourrin que de l’allusion distanciée. Reste que la scène la plus drôle l’est très certainement de façon totalement involontaire : après avoir renoncé aux femmes à la fin du film (pour
d’obscures raisons d’ailleurs !), tous ces mâles extériorisent leur homosexualité latente et refoulée en lançant des formes dures, longues et pointues dans la cible d’un bar où seul les garçons
semblent admis : comme quoi ils feraient peut-être mieux de se servir d’autres parties de leurs corps que leurs poings pour se faire du bien tous ensemble…
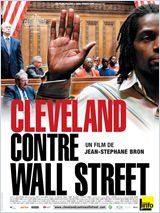
Note :![]()
Il n’est pas très étonnant, au fond, de voir des capitaux français financer un film pareil, accusant avec force et intelligence le scandale des « subprimes », ces nombreux crédits accordés par
les banques américaines à des pauvres gens qui n’en avaient pas les moyens… les obligeant par là même à hypothéquer leurs maisons pour une bouchée de pain et à se retrouver à la rue avec toute
leur famille ! Aux Etats-Unis, il n’y aurait sans doute eu guère qu’un homme comme Michael Moore pour mener une telle croisade, assurément avec plus d’humour et de dénonciations tape-à-l’œil.
Dans « Cleveland contre Wall Street », tout est finalement assez finement et clairement exposé, et c’est en cela que le film demeure une œuvre importante et même nécessaire à la démonstration
méticuleuse et indiscutable des méfaits du capitalisme et de ses dérives… Il est assez étonnant de voir comment le cinéma est utilisé comme prétexte au documentaire : il est dit d’emblée que nous
allons assister à un procès des habitants lésés de Cleveland contre les banques américaines, avec les vrais protagonistes (et non pas des acteurs), mais que ce procès n’a en réalité jamais eu
lieu, et n’aura probablement jamais lieu, tant Wall Street met des bâtons dans les rouages corrompus de la justice pour l’empêcher. Le film est alors le lieu du procès tel qu’il aurait du avoir
lieu, une forme d’uchronie prise avec le monde réel… C’est d’ailleurs la seule empreinte du cinéma en tant qu’art dans le film, puisque tout le procès est filmé sans véritables audaces dans un
style très documentaire, avec champs contrechamps assez classiques entre les plaignants et la défense. Idéologiquement efficace, « Cleveland contre Wall Street » reste plus simple dans sa forme,
ce qui le sert probablement mieux d’ailleurs, un peu comme un « documentaire imaginaire »…
Mise en perspective :
- Capitalism : a love story, de Michael Moore (Etats-Unis, 2009)
- La stratégie du choc, de Michael Winterbottom et Mat Whitecross
(Grande-Bretagne, 2010)

Note :![]()
![]()
Ultime volet de l’affaire Lisbeth Salander, duquel elle sortira enfin saine et sauve, mais surtout libre et victorieuse ! L’intrigue policière, à base de services secrets et d’obscurs groupes
trop puissants, nous emmène toujours de rebondissements en révélations en compagnie de personnages auxquels on a fini pas s’attacher… Dommage cependant que la mise en scène pèche un peu, traîne
la patte et manque d’audace, et surtout que le montage ne soit pas plus resserré : 2h30, c’est trop long pour un film qui aurait tout gagné à durer trois quarts d’heure de moins ! L’ensemble
paraît du coup trop souvent inutilement bavard et pas suffisamment elliptique… Les scènes au tribunal dans la dernière partie du long métrage font très « film de procès à l’américaine », avec
cette vision de la justice qui triomphe au final, un peu comme le miroir inversé du monde réel. On suit ça sans déplaisir, certes, on sourit même parfois, mais on est quand même très loin de
l’engouement annoncé et promis à l’origine de projet, construit sur le succès fulgurant de la saga littéraire signée Stieg Larsson…
Mise en perspective :

Note :![]()
![]()
Malgré quelques passages un peu confus (comme souvent, cependant, dans la saga « Godzilla »), cet épisode nous propose un scénario plutôt original, cherchant visiblement à creuser de nouvelles
pistes pour ce deuxième volet de ce que beaucoup appelle la deuxième grande période de la série, inaugurée en 1984 avec « Le retour de Godzilla ». Il est question en effet du professeur
Shiragami, vivant un peu reclus après la mort de sa fille dans un attentat contre son laboratoire, qui va parvenir à fusionner les cellules d’une plante avec celles de Godzilla, prélevées sur les
ruines de Tokyo après le dernier passage du monstre… Après la peur du nucléaire dans les films réalisés pendant la guerre froide, « Godzilla contre Biollante » évoque ainsi dès 1989 ses
inquiétudes sur les manipulations génétiques, les recherches sur l’ADN, les armes bactériologiques, les OGM… Un vrai petit film visionnaire, en somme !
Le monstre issu du croisement génétique donnera donc Biollante, une sorte de grand corps immobile surmonté d’une tête de rose : image plutôt étrange et pas franchement palpitante en matière
d’action, tant Biollante demeure d’abord statique et figé, tout juste bon à communiquer avec une jeune fille télépathe pour dire qu’il est peut-être la réincarnation de la fille du professeur… Au
secours ! Sauf que lorsque Biollante se métamorphose (allez savoir pourquoi…), il se met à posséder tout un tas de tentacules à gueules de plantes carnivores qui s’agitent dans tous les sens. On
se croirait carrément face aux monstroplantes du dessin animé « Jayce et les Conquérants de la lumière » ! C’est en tout cas l’occasion parfaite de retrouver tout ce que l’on aime avec « Godzilla
» : les combats de monstres géants, incarnés par des acteurs étouffants dans des costumes de plus de 100 kilos sur les épaules ! On peut regretter un côté un peu vite expédié des combats, mais
entre-temps Godzilla ira quand même faire un petit plongeon dans l’océan, menacera de s’approcher dangereusement de quelques centrales nucléaires, se prendra les lasers inutiles d’un vaisseau
militaire volant plutôt curieux, et viendra désosser quelques immeubles en cartons d’une maquette de Tokyo… Plein de choses pour prendre son pied donc, sans compter une magnifique bande sonore :
la musique est toujours bien appuyée et bien lourdaude et a souvent l’air de parodier les grands standards hollywoodiens signés John Williams (on croit reconnaître l’air des « Dents de la mer »
ou de « Star Wars » à certains moments, et chaque apparition de Godzilla est soulignée par un thème de quatre ou cinq notes bien grasses et bien détachées, supposées créer un climat d’angoisse :
un pur régal !)
Reste que la mise en scène n’est pas toujours exaltante et que le tout manque de rythme. Si certaines sous-intrigues ennuient ou laissent carrément sceptique, on sait cependant que le réalisateur
Kazuki Omori avait deux grands rêves dans sa vie : réaliser un épisode de Godzilla et un autre de James Bond. Etant parvenu à la moitié de ses ambitions avec « Godzilla vs Biollante », il a cru
bon d’incruster dans le scénario initial toute une série d’éléments de film d’espionnage, qui évoqueraient ainsi la saga de l’agent 007… Hélas, ces passages-là sont souvent assez confus : on
comprend pourtant que plusieurs agents d’organisations internationales visiblement diverses (Etats-Unis, Moyen-Orient…) s’affrontent pour récupérer les cellules de Godzilla et ainsi créer
d’autres monstres comme Biollante, essentiellement à des fins militaires. Même si ce ne sont pas les passages les plus convaincants du film, on peut quand même leur reconnaître le mérite
d’évoquer avec philosophie la terrible nature humaine… Comme le dit magnifiquement l’un des personnages : « Le vrai monstre n’est ni Godzilla, ni Biollante, mais l’homme qui les a créés ! »
Mise en perspective :
- Godzilla vs. Mechagodzilla, de Jun Fukuda (Japon, 1974)
- Godzilla & Mothra : The battle for Earth, de Takao Okawara
(Japon, 1992)
- Godzilla vs Megalon, de Jun Fukuda (Japon, 1973)
- Gamera, le monstre géant, de Noriaki Yuasa (Japon, 1965)
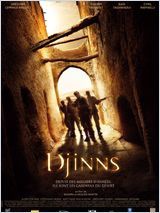
Note :![]()
Ce n’est pas la première fois que le cinéma français s’essaie au cinéma de genre, et ce n’est pas la première fois non plus que ce n’est pas une franche réussite… Malgré des psychologies
simplistes et des dialogues plutôt sommaires, le début du film sait pourtant se faire intrigant. Le désert, des soldats, une mission, du mystère… Le petit groupe fait même face à une offensive
ennemie, efficacement réalisée ! En matière de mise en scène et d’image, on sent que des efforts ont été faits. Sauf qu’une fois la « citadelle » atteinte, dans laquelle les soldats vont trouver
refuge mais être en réalité confrontés aux « djinns, ces esprits maléfiques du désert », le long métrage se retrouve très vite à faire du surplace : on comprend trop rapidement de quoi il s’agit,
les vagues rebondissements sont archi attendus, et surtout les effets spéciaux, surprenant au début, ne se renouvellent pas et sombrent finalement dans le ridicule… On s’ennuie ! Côté casting,
Grégoire Leprince-Ringuet fait ce qu’il peut, mais tous les autres sont d’une nullité risible et absolue : la palme revient à Thierry Frémont, qui essaie d’impressionner en criant, mais qui est
au final pénible et lourd. Reste peut-être à sauver le sous-texte politique, finalement audacieux, évoquant les méfaits de la présence armée française en Algérie en 1960 et surtout le premier
essai nucléaire français dans le désert algérien sous le nom de code « Gerboise Bleue »… mais c’est tellement mal amené et relayé en arrière plan que ça ne casse au fond pas trois pattes à un
canard ! Dommage…
Pour sa participation au grand concours de l'été "Oh my Godzilla !" (auquel vous n'avez plus
que jusqu'à samedi soir minuit pour jouer !), Nico du blog de Vance propose ce superbe dessin, éminemment politique, dans lequel il dit
vouloir "montrer comment il perçoit le godzilla américain face au vrai godzilla kaiju". On assiste bien sûr à la victoire haut la patte de l'original japonais, artisanal et plein de charme,
contre sa pale copie américaine, virtuelle et pixellisée à mort, trop lisse pour être honnête... Je vous laisse admirer tout le sens et le génie du détail !

Note :![]()
![]()
A travers cet « Arbre », Julie Bertucelli livre un merveilleux film sur le deuil, d’une grande douceur et toujours conduit par la sève de la vie, qui n’oublie jamais où se trouvent ses racines…
Dans une belle maison en Australie, entourée de magnifiques paysages et placée à l’ombre d’un immense figuier, Dawn doit faire face à la mort soudaine de son mari, entourée de ses quatre enfants…
On observe, dans un style presque documentaire et avec un naturel souvent désarmant, les réactions très diverses de chacun devant la disparition de la figure paternelle de la cellule familiale,
peut-être à tout jamais brisée.
Les portraits des personnages et leurs passions si humaines sont décrites avec beaucoup de simplicité et d’amour. Malgré la solitude apparente de chacun et les tensions qui semblent d’abord les
éloigner, on sent que des liens très forts les unissent et les uniront toujours… Ils sont cinq, mais ils forment un tout cohérent : une famille. La symbolique de l’arbre est en cela très
pertinente : omniprésente d’un bout à l’autre du film, elle est filée jusqu’à un arbre généalogique dessiné par un enfant et posé nonchalamment sur une table… La place démesurée de l’arbre dans
le jardin permet à chacun de faire son deuil, à sa manière. Simone, 8 ans, est persuadée que son père s’est réincarné dans l’arbre, et elle fera tout pour empêcher son abattage, au prétexte qu’il
prend trop de place et menace la maison… Quand une branche s’abat sur la maison et vient choir sur le lit de Dawn, celle-ci se couche à ses côtés assez naturellement, comme pour passer une
dernière nuit avec celui que l’arbre représente. Mais les racines s’étendent, détruisent les canalisations et menacent les fondations même de la maison : jusqu’où peut-on laisser la nature
reprendre le dessus sur la civilisation ? ou la passion sur la raison ? ou métaphoriquement parlant, jusqu’où peut-on laisser la vivacité du souvenir du disparu menacer le présent et l’avenir des
vivants ? Après le passage d’une tempête salvatrice, l’arbre est déraciné, la maison détruite et la famille peut repartir sur les routes, aller de l’avant, pour se reconstruire… Non sans avoir
replanté une pousse de l’arbre auparavant, afin de ne pas oublier le passé.
En somme, « L’arbre » est un film hyper symbolique, riche de signes multiples, et on pourrait facilement lui reprocher d’abuser de son allure de fable environnementaliste. En effet, entre les
grenouilles qui sortent des toilettes, la chauve-souris qui s’introduit dans la cuisine (effrayant par là même la mère), ou encore cette nuée de perruches sauvages qui avaient pris possession de
l’arbre le temps d’une absence de la famille durant quelques jours et qui s’envolent à leur retour, on nage en plein conte écolo, dressant des parallèles ambivalents entre nature et culture,
entre une flore et une faune sauvage du côté de la peur et de la pulsion et une maison qui normalement représente la sécurité et la chaleur d’un foyer. Mais c’est justement cette omniprésence de
la nature qui rend le film si beau, qui lui donne toute sa poésie, sa magie pourrait-on dire, et sa force évocatrice !
Si la fin peut apparaître ambiguë sur le message délivré, montrant la famille se lançant sur la route à la découverte du vaste monde mais pourtant coincée dans l’habitacle d’une voiture et
refusant toute intrusion d’un étranger (Dawn refuse l’amour que lui offrait pourtant un autre homme), on reste enchanté par la beauté de ce bel ensemble, en grande partie porté par la justesse de
ses interprètes : les enfants sont tous très bien dirigés, et Charlotte Gainsbourg est vraiment touchante dans le rôle de cette mère hyper sensible…

Voilà que débute aujourd'hui la toute dernière semaine pour envoyer vos contributions au grand concours estival de Phil Siné : le subtilement bien nommé "Oh my Godzilla !"
Vous avez en effet jusqu'au samedi 21 août à minuit, cachet du mail faisant foi, pour jouer... et peut-être gagner l'un des magnifiques cadeaux mis en jeu, comme un coffret double DVD contenant
pas moins de 2 films de la saga du célèbre monstre Godzilla ou un magnifique T-Shirt à tirage unique (taille M) dont vous pouvez désormais admirer le visuel ci-dessus. Il n'y a donc plus une
seconde à perdre !
Modalités de participation et plus d'informations en cliquant sur ce lien...
Seulement 3 participants pour le moment, dont vous pouvez admirer les oeuvres en cliquant sur les liens ci-dessous :

Note :![]()
Le réalisateur de films d’horreur japonais Hideo Nakata (« Ring ») se lance dans un nouveau genre de cinéma avec « Chatroom ». A première vue assez proche du film générationnel, le long métrage
se veut d’abord une immersion dans l’univers de la jeunesse actuelle, lâchant peu à peu prise avec le monde réel pour se vautrer dans les mondes virtuels, souvent communautaires, où les
rencontres et les liens se tissent à l’intérieur des fameuses « chatrooms », ces salons de discussions en ligne où l’on se connecte exclusivement par affinités… Le cinéaste tenait probablement là
un sujet en or, capable de capter le malaise identitaire des adolescents d’aujourd’hui, amplifié par le phénomènes d’écrans (d’ordinateurs, de téléphones…) qui les aliènent. Le suicide est
évoqué, se référant à un phénomène de plus en plus inquiétant auprès des jeunes, tout spécialement au Japon, justement, la patrie d’origine de Nakata. Sauf que tous ces thèmes ne sont finalement
qu’effleurés et esquissés, puis très vite délaissés au profit d’un thriller psychologique, excluant par là même toute dimension universelle…
Au fond, ce n’est peut-être pas un mal, puisque ce thriller, bien que pas toujours parfaitement abouti, demeure plutôt efficace et se laisse regarder avec plaisir. « Chatroom » n’est du coup
peut-être pas un grand film, mais demeure un bon film ! On y suit l’itinéraire de William, adolescent perturbé qui prend son pied en poussant d’autres jeunes à se suicider devant leurs webcams.
Pour repérer des cibles potentielles, il ouvre une chatroom aguicheuse pour y converser avec quelques ados si possible mal dans leurs peaux… Une fois un bon petit groupe constitué, les
manipulations peuvent commencer. Les jeunes acteurs sont pour la plupart convaincants, en particulier Aaron « Kick-Ass » Johnson dans le rôle du dérangé William.
Si l’histoire n’est pas toujours à la hauteur, il convient cependant de remarquer l’habileté de la forme et le talent incontestable de metteur en scène d’Hideo Nakata. Dès les premières images
dans le monde virtuel, il sait créer une ambiance incroyable et superbe, avec ces errances dans les couloirs, à la recherche de portes, comme autant de chatrooms derrière lesquelles s’ouvrent
autant de mondes idéaux et rêvés… Le cinéaste établit clairement une dichotomie entre le cyber espace, constamment en mouvement et sursaturé de couleurs vives, et la vie réelle, où tout semble
terne et livide, avec des couleurs froides et malades… Le film semble en fin de compte mettre en évidence l’illusion de la bulle internet, où l’on croit d’abord sympathiser et se faire des amis,
tisser des liens très forts avec eux, mais où les apparences s’avèrent surtout presque toujours trompeuses ! La confrontation au réel à la fin du film, où les personnages se rencontrent « en live
» pour éviter un drame pour l’un d’entre eux, se soldera au fond par une profonde désillusion : le saut dans le vide de William, celui par qui ils s’étaient tous réunis et qui les avaient leurré,
ne marque pas le début d’une nouvelle ère plus éclairées, mais bien au contraire le retour à un enfermement encore plus fort de chacun des personnages, qui finissent par repartir seul de la
scène, les uns derrière les autres, sans même se regarder une dernière fois… Glaçant !
Mise en perspective :
- L’autre monde, de Gilles Marchand (France, 2010)

Note :![]()
Pour la petite histoire, cette version de « Elle et lui » est en réalité le remake d’un ancien film à succès de Leo McCarey lui-même, qu’il a réalisé pour se prouver qu’il savait encore faire de
bons films, suite à une période de vaches maigres dans sa carrière… Si les deux films portent le même titre en français, il est amusant de comparer leurs titres originaux en forme de clin d’œil :
le « Love affair » de 1938 devient « An affair to remember » en 1957. Dans l’affaire qui nous intéresse, justement, Nickie Ferrante, un séducteur un peu volage fiancé à une riche héritière, et
Terry McKay, sur le point de se marier à un homme d’affaire fortuné, se rencontrent au cours d’une croisière qu’ils font chacun en solitaire. Malgré leurs engagements respectifs, tous les deux
tombent forcément amoureux, et histoire de mettre un peu leur amour à l’épreuve, se promettent de se retrouver six mois plus tard, au somment de l’Empire State Building à New York, histoire de
renforcer tout le romantisme de leur aventure…
Devant pareille histoire, avec ce qu’il faut d’amour et d’empêchement de cet amour, on comprend très vite que l’on est dans la pure comédie romantique, entre sentimentalisme fleur bleue et
péripéties doucement mélodramatiques… Bien sûr, leurs retrouvailles au sommet du plus grand immeuble de Manhattan seront contrariées par des évènements qui les dépassent (Terry sera renversée par
une voiture peu avant le rendez-vous, accident qui la laissera paralysée des jambes), bien sûr aussi elle ne voudra pas lui dire la vérité sur son accident, afin de ne pas être une charge pour
lui… et bien sûr enfin, attendez-vous à ce que ça pleure dans les chaumières !
Le côté larmoyant du film est souvent souligné : les rendez-vous manqués, l’histoire de la grand-mère de Nickie, triste évocation du temps qui passe et de notre nature mortelle, la présence
d’enfants par-ci par-là, puisque c’est toujours attendrissant (paralysée, Terry deviendra professeur de chant pour une chorale de bambins d’âge divers)… etc. Mais après tout, la larme un peu
facile est aussi le passage obligé de ce genre de cinéma, et « Elle et lui » sait bien souvent se faire beaucoup plus subtil !
Certains choix de mise en scène, par exemple, parviennent à créer une certaine distance, et comme une douce ironie sur cette bluette sentimentale… Le premier baiser que les personnages échangent
demeure notamment invisible aux yeux des spectateurs, qui doivent pour le coup l’imaginer, la caméra cadrant ce moment à hauteur de jambes dans un escalier où les deux tourtereaux avaient
commencé à grimper. Lorsque le bateau revient au port, également, Nickie et Terry se moquent de leurs comportements sur le pont lorsqu’ils aperçoivent en bas leurs fiancés respectifs, qui les
attendent sur la terre ferme : le montage alterne chacun d’entre eux en champ contre-champ d’abord, avant de révéler enfin en plan d’ensemble qu’ils sont séparés par quelques autres plaisanciers
qui les observent attentivement en tournant alternativement leurs têtes à gauche ou à droite… Le film sait ainsi se faire savoureux, réservant même à plusieurs reprises des pures scènes de
comédie ! On pense notamment à toutes celles sur le bateau, où cherchant à ne plus s’afficher ensemble aux yeux des autres voyageurs, ils n’arrêtent finalement pas de tomber par hasard l’un sur
l’autre au bar, sur le pont, à la piscine… jusqu’au restaurant, où tout le monde s’amuse en les regardant, tous les deux s’étant assis dos à dos sans s’en rendre compte… La scène à l’Empire State
Building est également assez amusante, montrant Nickie attendre Terry à chaque ouverture de l’ascenseur, d’abord tout guilleret et dynamique, puis finalement plutôt sinistre quand il se retrouve
seul et qu’il comprend qu’elle ne viendra pas.
On rit de bon cœur, donc, et l’on peut facilement s’émouvoir, même si les ficelles demeurent un peu épaisses… Sauf que « Elle et lui » nous laisse en compagnie de Cary Grant et Deborah Kerr, ce
qui est quand même la classe, et demeure un modèle du genre romantico-lacrymal, qui, en créant un certain nombre de clichés, inspirera tant et tant de cinéastes par la suite, pour le meilleur ou
plus souvent pour le pire… On se souvient notamment du clin d’œil dans « Nuits blanches à Seattle », où l’éternelle et incorrigible sentimentale Meg Ryan est en larme en regardant le film en
vidéo avec ses copines et ne peut s’empêcher de donner un premier rendez-vous à son futur amoureux… au sommet de l’Empire State Building !