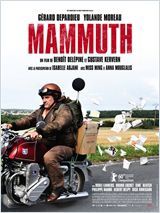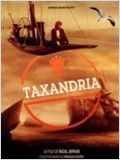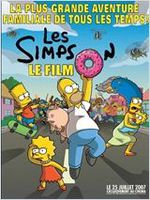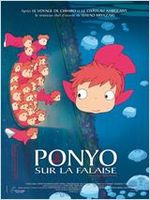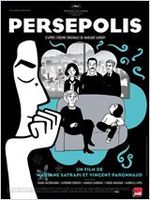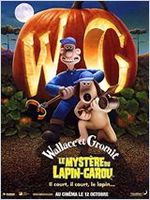Note :![]()
![]()
![]()
Le titre original de « London Nights » s’avère nettement plus significatif que cet étrange titre en anglais proposé pour son exploitation française. « Unmade beds » évoque en effet une forme
d’intimité, de sensualité, image d’une sexualité déréalisée dans un demi-sommeil… Ces « lits défaits » font également penser à la jolie anecdote qu’Axl nous raconte à l’ouverture du film : il a
compté le nombre de lits dans lesquels il avait dormi au cours de sa vie et il arrive à 20, exactement un pour chacune de ses années sur terre… Il trouve un vingt-et-unième lit en arrivant à
Londres, dans un squat où il va se mêler à d’autres jeunes gens un peu perdus. Alors qu’Axl s’est mis en quête de son père, qui l’a abandonné à sa mère alors qu’il était encore enfant, Vera se
remet d’une rupture amoureuse bien difficile… Tous les autres sont comme eux, à la recherche d’un peu plus d’amour et de tendresse dans la moiteur de la grande ville…
Presque aussi jeune que ses comédiens, le réalisateur Alexis Dos Santos (qui joue également dans son film) dresse un superbe portrait d’une jeunesse magnifique, peuplée de post-ado paumés dans la
mélancolie des nuits urbaines. Ils sont tous en quête d’un peu plus de plaisir et d’un bonheur idéal… Malgré leur détresse, malgré leur insignifiance, il les filme avec une telle puissance et une
telle grâce qu’ils ne peuvent qu’apparaître plus touchants encore. Il réussit à saisir l’insaisissable dans leurs comportements et dans leurs errances quotidiennes. Il montre leurs corps et leurs
peaux sublimes se mêler dans un désordre d’ivresse et de chair magnifique ! Certaines scènes de sexe, notamment celle mettant en scène un trio improvisé, laisse transparaître une sensualité
incroyable et une tendresse infinie en dépit de la trivialité des situations… Une forme d’amour brut, en somme !
Le plus marquant dans « London Nights », c’est peut-être l’omniprésence de la musique, qui semble toujours s’immiscer dans la vie des personnages ou même s’adapter à elle… Une musique jeune,
rock, dansante ou lascive, qui rythme indéniablement leurs petites vies précaires et instables, leur conférant à chaque fois le bon tempo. Dans les bars et dans les boîtes, dans la rue avec un
lecteur mp3, dans le squat où tournent les vinyles sur une ancienne platine, ces jeunes gens en ont constamment plein les oreilles ! A défaut d’adoucir leurs mœurs, la musique berce leur
existence, révèle leurs émotions, les accompagne lors de soirées alcoolisées auxquelles succèdent des réveils amnésiques ou marque la fin d’une relation. Ainsi, la rupture mal vécue par Vera est
accompagnée ironiquement par la célèbre chanson « Ti amo », qui émane cependant d’un 45 tours rayé…
Brillamment et subtilement mis en scène, très justement interprété (mentions spéciales à Fernando Tielve et Déborah François), le film fourmille d’idées incroyables et réjouissantes ! Des
séquences entières en mode photographique ou en super 8 figurent « la mémoire et les pensées intérieures des personnages » selon le réalisateur lui-même. Vera se demande si elle n’a pas épuisé
toute sa chance le jour où elle a traversé un labyrinthe en un temps record, choisissant alors la bonne voie à chaque croisement, et si elle n’arrête pas de se tromper à chaque fois de route
depuis lors… Lors d’un travail éphémère dans une librairie, elle a l’idée de (dé)ranger les livres aux mauvais endroits, afin que l’on puisse y tomber dessus totalement par hasard. Axl se fait
passer pour un jeune étudiant à la recherche d’un logement lorsqu’il retrouve son père dans une agence immobilière : ne pouvant finalement pas lui dire la vérité, il pleurera en musique et ne
gardera de lui qu’un briquet… La musique, encore et toujours, lorsqu’on le voit danser frénétiquement et chanter devant sa glace, un casque sur les oreilles, sur la chanson « Hot monkey »… Moment
émouvant, comme en suspension dans les airs, d’un personnage magnétique et généreusement attachant ! La même chanson reprendra un peu plus loin, dans une soirée où le jeune homme porte un masque
de singe : le film révèle alors une fois encore son étrange et fascinante poésie, quand un gorille rencontre une antilope au milieu de la jungle urbaine... C’est doux, c’est beau, et c’est d’une
intensité cinématographique remarquable et renversante !