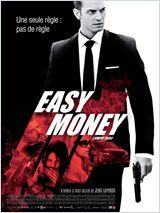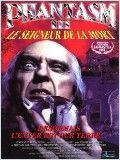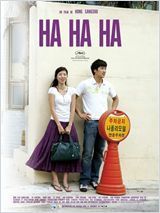Les sentiers de la gloire, de Stanley Kubrick (Etats-Unis, 1957)
Note :![]()
![]()
![]()
![]()
Censuré en France pendant près de 20 ans par peur de « porter atteinte à la dignité de l’armée française », « Les sentiers de la gloire » est effectivement un film profondément antimilitariste…
En 1916, dans les tranchées de la première Guerre mondiale, un général ambitieux et soucieux de sa renommée pousse des centaines de soldats dans l’attaque suicidaire d’une position ennemie
parfaitement imprenable. Après le carnage, le général veut faire fusiller la totalité des soldats encore en vie, qu’il accuse de lui avoir désobéi en refusant d’aller au front comme les autres…
Tempéré dans sa folie par le colonel Dax (formidable et grandiose Kirk Douglas), seuls trois soldats désignés au hasard seront jugés et tués « pour l’exemple »… Un procès à la va-vite sous la
forme d’un « conseil de guerre » tiendra lieu de « parodie de justice ».
Comme à chaque fois dans le cinéma de Kubrick, nous nous retrouvons ici devant un monument de perfection visuelle ! On admire à chaque plan la précision géométrique avec laquelle la caméra se
dirige, pour délivrer à l’écran un déluge d’images épurées et sans bavure… La première partie du film, description précise et quasi chirurgicale d’un fait de guerre marquant, se compose d’une
mise en scène devenue mythique : travellings arrière suivant les mouvements du général dans les tranchées, puis travellings latéraux sur les soldats avançant difficilement au front pendant
l’assaut… Le cinéaste, visiblement omniscient, a toujours l’œil et sait à chaque fois où il va, révélant à nos yeux le plan exact à la seconde et au mouvement près, sans jamais en faire trop… Une
pure merveille et une jouissance cinéphilique absolue !
Avec « Les sentiers de la gloire », Kubrick délivre ainsi dès 1957 (bien avant, notamment, « Full metal jacket ») une œuvre exemplaire, qui pourrait passer aisément pour un modèle définitif du
film non pas « de » guerre mais bien « sur » la guerre. Non pas donc une illustration héroïque de faits d’armes, mais bel et bien le contraire : une dénonciation brutale et politique de la
tragédie guerrière ! Le choix de la première guerre mondiale n’est d’ailleurs probablement pas innocent pour constituer ce « modèle », dans la mesure où elle est la matrice de toutes les guerres
« modernes », qui ont marqué le vingtième siècle…
Par le biais d’un scénario infaillible et de dialogues exemplaires, Stanley Kubrick réussit ainsi à souligner avec une force nécessaire l’absurdité du système militaire et plus généralement de la
guerre. L’ambition et la cruauté des chefs, qui ne cherchent qu’à se faire valoir, en dépit de la vie de leurs propres hommes, dénotent très vite le cynisme et le manque d’humanisme qu’engendre
le milieu guerrier. Le colonel Dax, chargé de défendre les trois soldats condamnés au cours de leur procès expéditif, renvoie du mieux qu’il peut les « bourreaux » à leurs contradictions et à
l’illégitimité de ce procès, en vain… Plus sournois est le retournement dans la définition même de l’ennemi auquel procède habilement le film : les allemands restent finalement invisibles et les
soldats sont finalement condamnés à mort par leurs propres supérieurs hiérarchiques, qui se révèlent ainsi les véritables ennemis… Aberrations d’un système qui marche sur la tête ! L’émotion
demeure constante au cours du film, le spectateur étant en fin de compte invité à vivre le calvaire des soldats au plus près de leur ressenti, mais c’est dans la scène finale qu’est atteint un
niveau paroxystique dans le sentiment humain : après s’être moqués d’une jeune allemande faite prisonnière, tous les soldats sont profondément touchés de l’écouter chanter, reprenant même
sincèrement l’air qu’elle interprète… Au fond, la musique – et l’art en général – vient à bout de toutes les frontières et de toutes les séparations entre les hommes : elle est synonyme de paix
et pourrait faire oublier la guerre une bonne fois pour toute… Hélas, la nature humaine reprendra toujours le dessus…