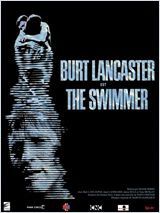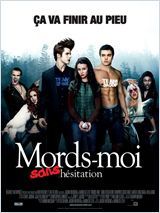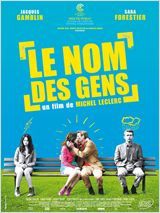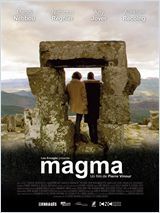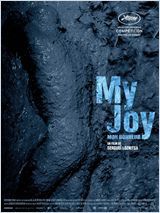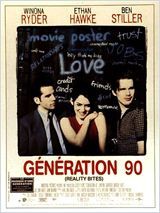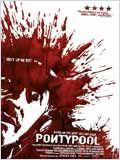
Note :![]()
![]()
Parmi l’offre contemporaine un rien pléthorique dans le domaine du film de zombies (genre définitivement passé dans l’« entertainment mainstream » après avoir été pendant longtemps l’apanage de
quelques élus passionnés et un rien détraqués), « Pontypool » sait s’imposer par une approche novatrice et audacieuse du genre. Très conceptualisé, le film réussit surtout un décalage sur la
brèche, qui aurait pu s’avérer très casse-gueule et qui crée finalement une forme et un contenu tout à fait passionnant…
Construit en huis clos, le film de Bruce McDonald impose d’abord un univers confiné et presque théâtralisé. Unité de temps : une même journée, et surtout unité de lieu : le sous-sol d’une église,
où se trouve la station de radio locale de la ville de Pontypool. Grant Mazzy en est l’animateur vedette, imposant un ton très particulier à ses émissions, porté par un lyrisme très largement
teinté d’ironie… Dès le départ, donc, le décalage passe par la voix même du personnage, qui débite ses discours habituels, un rien blasé, au micro de la radio. Il a pour habitude de converser
avec la « faune » locale et de recevoir les appels des habitants de la ville, qui viennent un peu pour raconter leurs vies. Et c’est là que tout se joue : Grant et ses assistantes vont recevoir
des appels déstabilisants de l’extérieur qui leur apprend progressivement que de drôles de choses se passent juste au-dehors, une sorte de contamination virale de la population, avec des gens qui
se mettent alors à se dévorer entre eux comme des morts-vivants…
Avec un tel concept, le réalisateur prend donc le pari de terrifier son spectateur en ne montrant rien de la menace extérieure, du moins dans un premier temps, jusqu’à ce que le mal s’introduise
dans la station… Le plus fort est que ça marche ! Le film parvient à nous tenir habilement en haleine avec trois fois rien, notamment à l’aide d’une mise en scène souvent resserrée sur le visage
de l’animateur radio, que l’on observe ainsi à fleur de peau et dont on sent peu à peu la tension l’envahir et le chambouler. Un gros travail sur le son a également été fourni, notamment
sur d’étranges voix perçues par le biais des appels téléphoniques… Tout circule par les ondes, et c’est bientôt par là aussi que le film va véritablement se révéler…
En effet, plus fort que le virus habituel qui se transmet par l’air ou le sang, « Pontypool » invente la transmission par les mots même. Le langage devient alors la menace, et plus
particulièrement les échanges verbaux de l’affect et de l’amour… La diffusion des programmes radio devient donc elle-même menace pour le reste du monde, susceptible de la capter ! Détail amusant,
ce n’est que la langue anglaise qui semble infectée, ce qui donne l’occasion aux personnages de s’exprimer dans d’autres langues, et notamment dans un français approximatif rigolo pour tout
francophone qui fera l’expérience du film en VO ! Le film s’achève bien sûr par une solution trouvée par le héros pour stopper le fléau, et cette solution procure au film une dimension poétique
vraiment surprenante et bienvenue… La conclusion de Grant Mazzy est qu’il faut désapprendre le langage et rendre les mots comme des coquilles vides. Quand la sémantique du vocabulaire s’enfuit,
c’est le carcan de notre expression humaine qui disparaît, ce qui libère ainsi notre véritable capacité à ressentir les choses, sans forcément devoir les conceptualiser et par là même les
dénaturer… L’expérience de langage vocale que tente le personnage à la fin à travers son micro se rapproche de la poésie moderne, qui joue sur les sonorités et les sens, au point de transformer
complètement la langue. Mais bien plus que de poésie, c’est à une pure expérience philosophique que « Pontypool » se livre ici sous nos yeux incrédules et passionnés !
Mise en perspective :
- Survival of the dead, de George A. Romero (Etats-Unis, 2010)