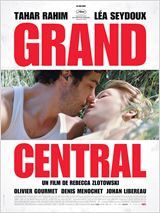Huit femmes
de François Ozon
(France, 2001)
Passez un été "en chanté" avec Phil Siné !





Dépité de n’avoir pu obtenir les droits du « Women » de Georges Cukor, François Ozon s’est tourné, sur un conseil de son agent Dominique Besnehard, vers une vieille pièce de boulevard ringarde et
poussiéreuse des années 50 signée Robert Thomas, « Huit femmes », afin de réaliser un film avec uniquement des femmes au générique ! Ce qui est (presque) vrai avec ce long métrage, le seul homme
de l’histoire étant déclaré mort dès sa première scène à l’écran, et chacune de ses « apparitions » (lors de flash-back essentiellement) le montrant toujours de dos, le visage invisible… Soit
donc huit femmes enfermées en huis clos dans une maison isolée la veille de Noël, qui apprennent que le patriarche vient de mourir assassiné : de mensonges en révélations, chacune dévoile bien
involontairement sa raison d’avoir commis le crime, sachant que l’une d’elle est forcément la coupable… Et si ce jeu de Cluedo à la Agatha Christie se révèle plutôt plaisant et amusant, force est
de constater assez vite que ce n’est pas l’intrigue qui intéresse le plus Ozon, même s’il a fait ce qu’il a pu pour remanier et surtout moderniser une pièce de théâtre vieillotte.
Ce qui intéresse le cinéaste, c’est au contraire toute la distance qu’il peut prendre avec son intrigue. Il en rajoute sans cesse dans la théâtralisation et incite les actrices à surjouer comme
ce n’est normalement pas permis au cinéma ! Les décors, les costumes, les postures et les mimiques des personnages : tout, absolument tout, sonne volontairement faux ! L’exagération est de mise
comme le révélateur kitsch d’une mascarade de l’existence, des apparences et des sentiments… Ozon instille néanmoins de la mise en scène et du cinéma dans toute cette superficialité, mais il le
fait là encore comme une provocation : toutes une scène de dialogues entre les huit personnages est ainsi filmée intégralement en gros plans, ceci afin de se moquer des anciennes actrices
hollywoodiennes qui exigeaient toujours d’avoir « leur » gros plan au cours du film… Le réalisateur s’amuse aussi énormément avec les positions de ses actrices dans les plans, se cassant souvent
la tête pour réaliser ce qu’il appelle lui-même des « plans brochettes », dans lesquels il pourra intégrer un maximum de comédiennes dans la même image…
Là où excelle « Huit femmes », c’est justement dans sa glorification à outrance de ses huit actrices. Il faut dire que l’on sent à la fois la fierté et le plaisir jamais dissimulé d’Ozon d’être
parvenu à réunir à l’écran autant de grandes stars ! Ca relève tout autant du fantasme que du challenge : Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Isabelle Huppert, Emmanuelle Béart… comment tout cela,
avec les caprices et les exigences de chacune, va-t-il bien pouvoir coexister sur un même plateau de tournage ? C’est, semble-t-il, ce que le cinéaste s’est amusé à nous montrer à l’écran : il
faut les voir, toutes ces femmes, se quereller et s’invectiver en permanence, dévoilant les mœurs secrètes des unes, jetant les vilains défauts et les quatre vérités à la face des autres… On
s’interroge alors sur ce que l’on voit : des actrices jouant des personnages ou des personnages révélant les oppositions des actrices ? On prend quoi qu’il en soit un plaisir immense à les voir
s’envoyer toutes ces piques en permanence, d’autant que le réalisateur se plait à confronter le style et les conventions d’une époque révolue avec des mœurs plus modernes : « Une fille ! voilà ce
que tu es : une fille ! » dit la mère à sa fille tombée enceinte hors mariage, « C’est une invertie ! » clame la grand-mère scandalisée d’apprendre que la domestique couche avec des femmes…
On jubile aussi parmi tout ce vacarme et ces portes qui claquent, notamment devant des répliques purement savoureuses et même parfois absurdes : « Parce qu’on m’a respecté moi ! », dit Huppert la
vieille fille pour éviter de dire qu’elle est encore vierge, « Ouvre le placard, je vais la ranger », déclare Deneuve après avoir assommé la grand-mère, histoire de se débarrasser un moment de la
vieille… C’est cinglant, c’est irrévérencieux… et tellement délicieux ! Et si la pièce d’origine possédait un côté forcément misogyne à montrer ce pauvre homme tiraillé entre ces huit furies
hystériques, on découvre ici que les hommes, désormais absents pour être morts, avoir fuit ou être inconstants, n’ont pas de leçon à donner à ces huit femmes seules…
Huit femmes seules et tristes, au fond, que les airs de comédie musicale du film viendront un temps réenchanter ! Chaque actrice aura droit à sa chanson, réinterprétant et revisitant la plupart
du temps un vieux standard kitsch de la variété française : l’entraînant « Papa t’es plus dans le coup » de Sheila pour Ludivine Sagnier, l’émouvant « Message personnel » de Françoise Hardy pour
Isabelle Huppert, le mignon « Mon amour mon ami » de Marie Laforêt pour Virginie Ledoyen, le sensuel « A quoi sert de vivre libre » de Nicoletta pour une Fanny Ardant plus « Gilda » que jamais,
l’audacieux et foufou « Pile ou face » de Corinne Charby pour Emmanuelle Béart, et ainsi de suite… Chacune accompagne l’interprétation d’une chorégraphie presque ridicule, aux frontières de la
parodie. Et si ces chansons n’apportent strictement rien au récit lui-même, elles sont l’occasion de le faire respirer, d’amuser le spectateur forcément enthousiaste, et de se présenter comme
autant de vignettes sur la personnalité des personnages, ajoutant à la charge de leur caractérisation caricaturale déjà amenée par leurs vêtements, leurs couleurs, leurs « tics » ou la fleur qui
les représente dans le générique d’introduction du film…
Mais « Huit femmes » se voulant un hommage puissant aux actrices et à leur aura mythique, François Ozon ne pouvait se contenter de les montrer s’étripant et se jetant leurs haines respectives…
Outre la photo de Romy Schneider qui apparaît mystérieusement dans la poche de la bonne et un tableau de Catherine Deneuve jeune, comme figures de l’atemporalité de la beauté des actrices filmées
et retenues à jamais par le celluloïd, le cinéaste opère progressivement à un glissement dans les rapports entre les actrices, qui passent de la haine à si ce n’est de l’amour au moins à une
forme d’union… La scène de la bagarre sur le tapis entre Catherine Deneuve et Fanny Ardant, qui se termine en étreinte charnelle et en gros bisous sur les lèvres (fantasme absolu de cinéphiles
!), en est bien entendu la représentation emblématique et « culte » ! Mais la chanson finale de Danielle Darrieux, « Il n’y a pas d’amour heureux », la seule véritablement « littéraire » (sur un
texte d’Aragon), met également bien tous ces personnages sur un pied d’égalité devant l’échec de leurs vies sentimentales… On assiste également à une forme de transmission merveilleuse entre la
vieille actrice légendaire (Darrieux), qui prend sous son aile la jeune actrice qui a encore tout à prouver (Ludivine Sagnier) : l’idée de transmission et d’union entre les actrices, en dépit de
leur âge ou de leur carrière, qui sera confirmée encore une fois par le plan final, montrant les huit actrices se tenir par la main face caméra pour un (presque) « salut » avant la tombée du
rideau…
Autres films de François Ozon :
Dans la maison (2012)
Jeune et Jolie (2013)
Potiche (2010)
Le refuge (2010)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()