
(Belgique, France,
Luxembourg, Suisse, 2011)
Sortie le 5 septembre 2012
![]()
![]()
Le nouveau film de Joachim Lafosse, réalisateur des puissants « Nue propriété » et « Elève libre », s’ouvre sur sa fin, juste après que le drame ait eu lieu : une mère en pleurs à l’hôpital, qui
demandent à ce qu’on « les » enterre au Maroc, puis un plan large sur un avion chargeant quatre petits cercueils dans la soute… Spectacle glaçant, long et lancinant. L’histoire recommence alors
par le début, encore joyeux et insouciant : un jeune couple qui s’amuse, batifole, s’apprête à se marier et à vivre ensemble… Enfin, « vivre ensemble » est une bien grand mot pour Murielle et
Mounir, puisque s’immisce entre eux deux le bon Docteur Pinget, qui a accepté de ramener Mounir du Maroc et de le prendre sous son aile depuis des années : la coexistence de tout ce petit monde
dans la même maisonnée est à la fois troublante et de plus en plus dérangeante, perturbante, malsaine…
« A perdre la raison » étant tiré d’une histoire vraie, Joachim Lafosse sait parfaitement n’utiliser le fait divers que comme un prétexte pour une fiction symbolique. Son film se transforme en un
inéluctable drame familial sociologique, une critique sociale pure et précise, qui commence dans l’innocence pour se terminer dans l’horreur absolue… Entre temps, l’étau se resserre doucement
mais sûrement sur les personnages, en particulier sur Murielle, qui sombre dans une désespérance psychologique tragique. Le pire étant que l’analyse du cinéaste est claire et limpide, que l’on
voit avec clarté les relations ambiguës et les tensions assassines s’installer, laissant un climat d’oppression étrangler peu à peu le personnage… Le film montre avec justesse et subtilité ces
compromissions du quotidien, ces acceptations de choses qui mènent sournoisement les gens à leur perte. Le long métrage se fait fatalement étouffant, jusqu’à ce dénouement abominable que l’on ne
voit pas forcément tout de suite venir, filmé avec une douceur étonnante et profondément troublante : la mère appelle à elle chacun de ses enfants, qui la rejoignent à tour de rôle comme des
condamnés à mort parfaitement innocents, qui ne savent même pas ce qui les attend…
Si la mise en scène est toujours juste et directe, la dramaturgie d’« A perdre la raison » doit aussi beaucoup à l’intensité de ses interprètes ! Emilie Dequenne, la jeune « Rosetta » des frères
Dardenne, rôle qui lui valut un Prix d'interprétation au Festival de Cannes en 1999, est tout simplement bouleversante dans le rôle de cette mère en souffrance… Quant à Tahar Rahim et Niels
Arestrup, déjà réunis dans « Un prophète » de Jacques Audiard, ils incarnent un couple étrange et ambigu, dont on ne saura jamais véritablement les liens réels : entre manipulations et candeur
dérangeante, on sent bien qu’ils jouent un jeu dangereux qui sera le terrain propice à l’atrocité qui se prépare… Un film marquant et maîtrisé !

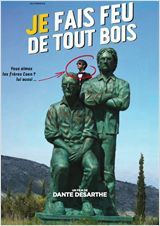

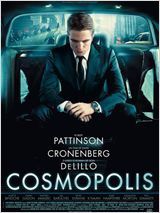








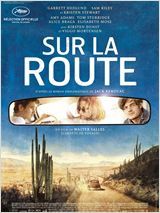 (France, Etats-Unis, Grande-Bretagne, 2012)
(France, Etats-Unis, Grande-Bretagne, 2012)


 (Etats-Unis, 2006)
(Etats-Unis, 2006)