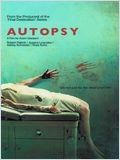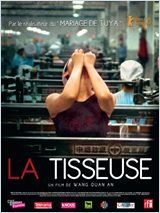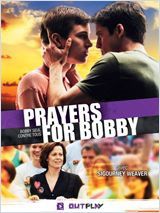Note :



Dans « Rosemary’s baby », son premier film hollywoodien, Roman Polanski prend son temps pour installer l’intrigue et ses personnages. On assiste à l’installation d’un jeune couple, Rosemary et
Guy Woodhouse, dans leur nouvel appartement, depuis la visite des lieux avec l’agent immobilier jusqu’à l’aménagement des différents meubles, à leur rencontre avec leurs étranges et vieux
voisins, les Casteveret, et à leur décision de faire leur premier enfant… On demeure d’abord admiratif de la mise en scène puissante et toujours maîtrisée du cinéaste, qui sait passionner son
spectateur avec souvent trois fois rien. La composition des plans, le soin accordé au montage, l’importance des sons : tout est mis en œuvre pour instaurer une atmosphère bien précise, qui saura
captiver sans esbroufe un public passionné.
« Rosemary’s baby » est parcouru d’un climat fantastique et horrifique, sans jamais verser pourtant dans les images sensationnelles ou exagérément sanglantes. Le film sait toujours rester sobre
pour doucement laisser s’insinuer une inquiétante étrangeté, issue du monde quotidien, capable d’éveiller chez le spectateur un sentiment d’angoisse et de malaise… La simple observation, lors de
la visite de l’immeuble, du déplacement d’un buffet pour entraver l’ouverture d’un placard où ont été laissé du linge et un aspirateur par l’ancienne locataire, devient un vrai mystère ! Polanski
va ainsi faire monter doucement une impression d’inconfort, à travers divers évènements ou comportements étranges, vus à travers les yeux de Rosemary, qui va mener à terme une grossesse «
infernale »… Soupçonnant tour à tour ses voisins, son docteur et son mari, de l’avoir placé, elle et son bébé, au cœur d’un complot monstrueux ! Il faut dire que les choses n’avaient pas très
bien commencé, quand la nuit de la conception de l’enfant, Rosemary fait un horrible cauchemar à base de messe noire et de copulation avec le Diable, et qu’au petit matin son mari lui apprend
qu’il l’a « violée » dans son sommeil, alors qu’elle était inconsciente, enivrée par l’alcool…
Tout le génie de Polanski est de laisser dans son film une constante ambiguïté, qui enveloppe l’intrigue d’un doute omniprésent. Rosemary est-elle véritablement manipulée par son entourage, dont
tous les membres appartiendraient alors à une secte satanique ? N’est-elle pas plutôt prise d’une paranoïa frénétique qui la transporte peu à peu aux portes de la folie ? A moins qu’elle ne soit
simplement en train de traverser le cauchemar que doivent subir toutes les femmes enceintes de ce monde pour donner la vie à celui qui leur déchire les entrailles pendant des mois ? La fin du
film ouvre d’ailleurs des perspectives tout aussi floues que ce qui a précédé : on fait d’abord croire à Rosemary qu’elle a perdu son enfant lors de l’accouchement, puis celle-ci, convaincue
qu’on lui ment, parvient dans une pièce où tous ceux qu’elle connaît forment un cercle sataniste autour d’un landau noir… Véritable enfant du démon ou simple métaphore du deuil, les langes
devenant alors linceul, d’autant plus qu’à aucun moment on ne voit l’enfant à proprement parler ? Pour parvenir jusqu’à cette pièce, Rosemary a par ailleurs du traverser l’autre côté du
mystérieux placard condamné au début du film, symbole probable du passage, comme celui « de l’autre côté du miroir »… Rien ne permet donc d’attester que nous sommes encore dans la réalité à ce
moment là ou dans le pur fantasme du personnage devenu fou ! Une autre explication consisterait encore à interpréter le cheminement de Rosemary comme l’acceptation d’une mère de voir l’enfant
qu’elle porte abandonner sa chair pour se lancer seul dans le vaste monde et fatalement devenir mauvais et maléfique, comme tous les hommes, en somme, possèdent une part noire enfouie en eux…
Polysémique et mythique, Polanski réussit là un film riche et puissant, à la confluence de plusieurs genres qu’il a sinon inventé, tout du moins largement popularisé pour les décennies à venir,
qu’il s’agisse du film d’horreur ou du thriller paranoïaque ! Magnifié par l’interprétation de Mia Farrow et de John Cassavetes, « Rosemary’s baby » demeure encore aujourd’hui un « must »
incontournable du cinéma fantastique !
Mise en perspective :
- Le bal des vampires, de Roman Polanski (Grande-Bretagne,
Etats-Unis, 1967)
- The ghost writer, de Roman Polanski (France, 2010)

![]()
![]()