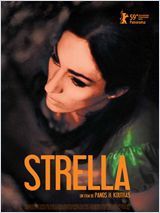Note :
Pour commencer par un bon mot, osons le dire bien haut : cette moussaka est un pur régal ! Tous les ingrédients y sont parfaitement dosés et c’est un bonheur pour les papilles… Loin d’être le nanar
que le titre laisse présupposer, « L’attaque de la moussaka géante » est avant tout une parodie efficace et réussie des séries B et autres films de monstres, genre Godzilla… Plus ou moins inspirée
par « L’attaque des tomates tueuses », son pendant américain (avec toute une série de films, dont le deuxième épisode est réputé pour voir figurer George Clooney à son casting !), la « Moussaka »
raconte comment, à la suite de la téléportation ratée d’une belle blonde extraterrestre (qui navigue dans l’espace à bord d’une soucoupe volante rose Barbie avec une belle brochette d’autres
blondes décérébrées), celle-ci se retrouve dans une part de moussaka qu’un petit garçon donnait à son chien. La part de moussaka, bien sûr, devient énorme et se met à terroriser toute la ville
d’Athènes, laissant de nombreuses victimes sur son passage. Le film joue à fond la carte parodique et les scènes de panique dans les rues de la capitale grecque sont des moments à hurler de rire :
tout le monde court dans tous les sens en criant alors que la moussaka avance à la vitesse d’un escargot sur eux… Pourtant, celle-ci parvient quand même à les atteindre et les tuer par des
magnifiques projections gazeuses ! C’est de la pure poésie… Le budget ultra-réduit du film (aucun acteur n’a été payé durant le tournage, souvent des amis du réalisateurs d’ailleurs), lui permet
d’étaler sa pauvreté à chaque plan : image dégueulasse, effets spéciaux ridicules (la moussaka est filmée en très gros plan et vaguement collée ensuite à une autre image avec les acteurs), décor
minimal, la même prise répétée trois fois (une montée d’escalier, histoire de montrer que le personnage grimpe haut dans l’immeuble)… Tout respire le film amateur fait par des amateurs –
amateurisme d’ailleurs parfaitement assumé et exploité –, ce qui le rend finalement réellement drôle et plaisant.
Le plus drôle, c’est que « L’attaque de la moussaka » ne se contente pas d’être un film potache, sorte de pastiche de pastiche ironique à souhait. Il propose en effet une véritable satire politique
(avec la présence, notamment, d’un homme politique dépassé par les évènements et incapable de gérer sa famille par la même occasion) et surtout une critique incisive des médias (si, si !) On
retrouve ainsi la télé quasi omniprésente tout au long du film, regardée de façon hypnotique par les divers personnages. Chaque chaîne relate seconde par seconde le déroulé du massacre de la
moussaka, chacune à sa manière : l’une axe sur le sensationnel, cherchant à montrer le plus de cadavres possible, l’autre cherche à calmer les esprits, le présentateur répétant ad libidum qu’il n’y
a pas lieu de paniquer, une autre encore dresse le thème astral de la moussaka… L’un des personnages principaux est d’ailleurs une journaliste, alliée à son caméraman, qui se montrera prête à tout
pour arriver à trouver une image ou un témoignage exceptionnel, histoire de faire décoller sa carrière.
Enfin, il est nécessaire d’évoquer tout le côté très « kitsch, camp & queer » du film, qui s’avère en réalité une œuvre « gay friendly » très en avance sur son temps… De la part d’un film grec,
est-ce vraiment étonnant ? Tout fleure bon l’homosexualité assumée et relâchée dans la « Moussaka géante » : la soucoupe volante très disco, certains passages en mode « comédie musicale », des
astrophysiciens qui s’enfilent tous en blouses roses, ainsi qu’un merveilleux trio de travelos branchés et top fashion, en goguette dans les rues d’Athènes, dont l’excellente Tara, héroïne grosse
et hyper-expressive, qui n’est pas sans rappeler la sublime Divine, la muse des films de John Waters… Les extraterrestres, toutes blondes et de sexe féminin, peuvent nous laisser supposer qu’elles
viennent d’un monde à peu près semblable à l’île de Lesbos. D’ailleurs, lorsque la femme de l’homme politique, plutôt frustrée sexuellement (son mari lui fait l’amour alors qu’elle reste
endormie…), s’échappe à la fin avec les filles de la soucoupe volante, alors même que son homme est mort, ne faut-il pas y voir la révélation de sa véritable identité sexuelle, enfin assumée ? Et
si elle laisse son fils derrière elle, au fond peu importe, puisque le nouveau couple formé par Tara la transsexuelle et l’astrophysicien gay, qui s’aime visiblement d’un amour sincère, sera là
pour le recueillir et peut-être… l’adopter ? Ainsi, ce superbe film sociologique de Panos H. Koutras s’achève sur une nouvelle image de la famille, recomposée et décomplexée, dont le modernisme
laisse éclater tout le génie de son réalisateur !