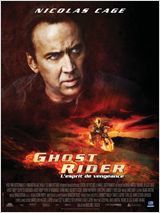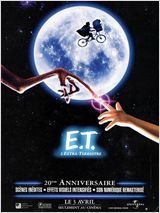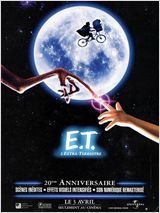
E.T.
l’extra-terrestre, de Steven Spielberg
(Etats-Unis, 1982)
Note :




« E.T. » est mon premier souvenir de cinéma : de tous les films existant, il le restera à tout jamais, et j’entretiendrai ainsi avec lui ce rapport si particulier et certainement si intime d’une
émotion qui se révèle quasiment intacte à chacune des visions que j’en ai, réminiscence de ce frisson originel de l’enfant que j’étais alors et qui m’a confronté pour la toute première fois à cet
art dont je me sers désormais comme d’un refuge… Mon désir infini de cinéma prend sa source dans ce premier film, jalon essentiel et nécessaire qui commença à me construire comme individu et
fondement initial qui allait bâtir ce à quoi ressemble ma cinéphilie aujourd’hui… Autant dire que le choix (bien malgré moi) de cette première séance de cinéma s’avérait crucial !
Trente ans après sa sortie, « E.T. l’extra-terrestre » conserve cette aura extraordinaire qui en fait un film véritablement important, autant dans l’histoire du cinéma que dans le cœur et
l’intimité de ceux qui l’ont vu pour la première fois lorsqu’ils étaient enfants. Même si sa ressortie « retouchée » en 2002 pour son vingtième anniversaire (et depuis en partie reniée par
Spielberg, qui conseille aux nouveaux spectateurs de découvrir le film plutôt dans sa version initiale) n’apporte pas grand chose et retire peut-être même une partie de la poésie du long métrage
(à cause notamment des retouches d’E.T. en images de synthèse), le film garde néanmoins ce pouvoir émotionnel immense, cet enchantement magique qui fait pétiller les yeux et transforme n’importe
quel spectateur en véritable gamin émerveillé… Car le film procède de cette grâce de l’enfance, ni forcément innocente ni bêtement sirupeuse, qui caractérise le cinéma primitif de Steven
Spielberg…
Il faut dire que le cinéaste a mis énormément de lui-même dans ce film, souvent décrit comme son œuvre la plus « autobiographique » : non pas que le petit Steven a fait copain-copain avec un
extraterrestre lorsqu’il avait dix ans, mais parce qu’il s’était créé un « ami imaginaire » pour palier à un père absent et à un manque de petits camarades de jeu, rendant son enfance très
solitaire… C’est exactement la situation d’Elliott, le jeune héros d’« E.T. », cadet d’une famille dont la mère élève seule les trois enfants et cherchant à intégrer la bande d’amis de son frère
à défaut d’en avoir dans sa propre classe… Pendant un long moment, il est d’ailleurs le seul à voir « l’extraterrestre » qui rôde dans leur jardin et même lorsque son frère et sa sœur l’aident à
s’en occuper, on reste en droit de douter de son existence réelle, tant les adultes semblent ne pas pouvoir le voir : la mère évolue ainsi dans la maison, frôlant parfois E.T., sans jamais
pourtant y prêter attention, probablement trop affairée à ses activités de « grande personne »… Tout le long métrage est d’ailleurs filmé « à hauteur d’enfant », la caméra se situant la plupart
du temps au niveau de la taille d’un adulte et Spielberg refusant quasi systématiquement de filmer les visages des adultes, hormis celui de la mère, qui symbolise le lien entre l’enfance et le
monde des grands pour les trois enfants de la famille… Il est étonnant également de voir le pouvoir de connexion si fort, aux accents fantastiques et inexplicables, qu’il existe entre Elliott et
son extraterrestre, rappelant en quelque sorte toutes ces amitiés sans limite, « à la vie à la mort », que l’on se promet lorsque l’on est encore des enfants…
Il s’avère absolument fascinant de voir et de revoir « E.T. » à travers les âges, tant l’universalisme des émotions ressenties à sa vision peut-être fort et tant surtout le film fourmille d’idées
et d’interprétations derrière le vernis d’une apparente simplicité… Les pistes de lectures sur le long métrage se révèlent alors presque infinies, pour peu que l’on veuille bien s’y pencher un
instant et voir dans le chef-d’œuvre de Spielberg autre chose qu’un simple film de divertissement familial et que l’efficacité toute américaine du blockbuster « mainstream »… Même si l’on veut
mettre de côté les dérives psychanalytiques que l’on peut en donner (certains ont vu dans la représentation de l’extraterrestre un véritable « étron sur pattes », soutenant ainsi que le cinéaste
jouait avec sa créature comme un enfant avec son caca), on peut tout aussi bien donner d’« E.T. » une lecture « homérique », dans laquelle l’extraterrestre, tel un Ulysse en plein odyssée, a beau
tisser des relations très fortes avec les terriens qu’il rencontre, n’en éprouve pas moins ce besoin rassurant de retourner auprès des siens (la fameuse réplique culte « E.T. téléphone maison »),
qu’une lecture presque mystique sur la quête de la foi, avec un E.T. qui progresse tel un Christ faisant l’expérience de l’incarnation (mouvement verticale de descente sur la Terre puis
d’ascension finale vers le ciel, avec entre temps une mort clinique suivie d’une résurrection, une guérison miraculeuse par l’application d’un doigt luminescent, ou encore une lévitation en vélo
qui rivalise largement avec une marche sur l’eau…) et qui a ses disciples (ceux qui le voient) et ses opposants (les adultes qui n’y comprennent rien, à de rares exceptions près).
Perspective :
- Les aventures de Tintin : le secret de la Licorne,
de Steven Spielberg

![]()
![]()
![]()