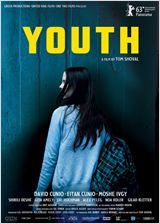Vendredi soir au MK2 Bibliothèque, c’était
Vendredi soir au MK2 Bibliothèque, c’était
un peu la soirée « femmes réalisatrices », voire « femmes » tout court du Festival Paris cinéma… Ainsi, outre les deux cinéastes Rebecca Zlotowski et
Katell Quillévéré dans la salle avant (voire après) les films (respectivement « Grand Central » et « Suzanne »), on pouvait également croiser les actrices Léa Seydoux (sur l’écran… mais
normalement aussi dans la salle dimanche soir pour la projection de « La vie d’Adèle »), Sara Forestier et Adèle Haenel (toutes les deux à la fois sur l’écran et dans la salle !) Quelle ne fut
donc pas ma surprise (agitant mes sens plus que de raison pour l’occasion) de retrouver également le choupinoux Johann Libereau et le magnétique Tahar Rahim à la projection de « Grand Central
» : ces deux-là se faisaient d’ailleurs plein de calinoux en sortant de la salle, prouvant visiblement que le tournage avait du rudement bien se passer… Mais le plus fou fut encore mes deux
sorties de projections ce soir-là, me faisant tomber tour à tour sur deux des nombreux hommes de ma vie (« Dreams… are my reality », tout ça…) : un Louis Garrel plus sexy que jamais, faisant d’ailleurs de mystérieuses allées et venues sur
le trottoir de l’avenue de France avec son beau vélo tout neuf et sa cour composée de jeunes filles à la foufoune prête à exploser et de Vincent Lacoste (sic), puis un Samuel Benchetrit en grande conversation téléphonique à proximité du Limelight, le QG des
stars du Festival… J’en vibre encore de tout mon être… et de tout mon corps, vous pensez bien ! Et dire que le Festival continue : faites vos jeux !
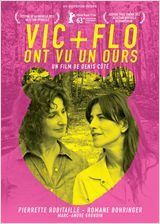
[En compétition]
Vic + Flo ont vu un ours, de Denis Côté
(Québec, 2012)
Sortie le 4 septembre 2013
![]()
Habitué du Festival (il était déjà en compétition il y a deux ans avec « Curling »), le
réalisateur québécois Denis Côté (auteur depuis du fascinant documentaire « Bestiaire »)
prouve au fil de ses films qu’il est véritablement un réalisateur à suivre, l’un de ceux qui possède un regard original et personnel sur le monde… Avec « Vic + Flo ont vu un ours », il débauche
Romane Bohringer (que l’on n’avait pas vu dans un rôle aussi important depuis trop longtemps…) pour dérouler un récit entre réalisme et inquiétante étrangeté… Autour d’une histoire d’amour entre
deux femmes, il laisse errer son film dans des directions tour à tour drôles, décalées, barges ou carrément violentes, capables de marquer avec force l’imaginaire du spectateur. Si le mystère –
du titre, de certains évènements, du dénouement… – peut parfois apparaître comme une facilité, on reste néanmoins fasciné par cet ensemble un peu fou, où les acteurs font merveille : on note
notamment le rôle de Marc-André Grondin, parfaitement méconnaissable le crâne rasé…
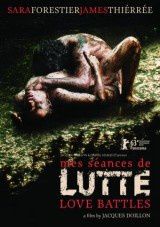
[Avant-première]
Mes séances de lutte, de Jacques Doillon
(France, 2012)
Sortie le 6 novembre 2013
![]()
Après un « Mariage à trois » bien trop sage et « Un enfant de toi » à la morale aux frontières de la pudibonderie, le nouveau film de Jacques
Doillon tente de se démarquer en proposant les « luttes » – au sens physique – d’un couple, dont les rendez-vous se transforment ainsi progressivement en corps à corps entre violence
sado-masochiste et sensualité… On comprend presque trop bien que ces « confrontations » sont au fond une métaphore d’une nouvelle forme de thérapie amoureuse, à travers une comparaison très
appuyée avec des « séances » de psychanalyse… A vrai dire, on voit venir la réplique finale à des kilomètres, verbalisant le fait que toute cette expression de haine à travers le choc des corps
est en réalité une preuve d’amour (wah…) : heureusement, elle vient mettre un terme à ce lent supplice qu’aura été la projection d’un film faussement sulfureux et surtout horriblement chiant,
dont on ne retiendra que la performance étonnante des deux acteurs principaux : James Thiérrée et Sara Forestier, cette dernière dans un contre-emploi saisissant… une vraie prise de risque de
leur part, qui ne sauve cependant pas le film !
Autres films vus dont nous parlerons très bientôt sur ce blog fabuleux :
- La cinquième saison, de Peter Brosens et Jessica Woodworth (Belgique, Pays-Bas, France, 2012)![]()
![]()
- Henri, de Yolande Moreau (France, 2012)![]()
- Tip Top, de Serge Bozon (France, 2013)![]()
![]()
- Grand Central, de Rebecca Zlotowski (France, 2013)![]()
![]()
Précédemment :
- Au cœur de Paris cinéma 2013 –
vol. 1 : Si le vent te fait peur / Prince Avalanche / Youth
- Au cœur de Paris cinéma 2013 – vol. 2 :
Elle s’en va / Kid / Pussy Riot

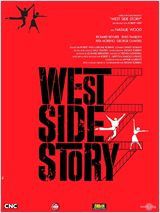
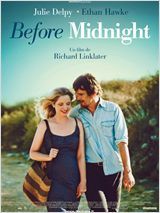
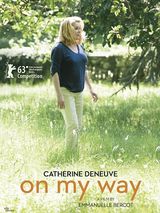 [Avant-première]
[Avant-première] [En compétition]
[En compétition]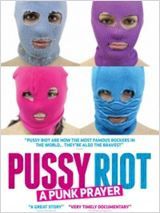

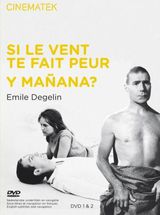 [Made
[Made