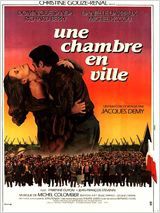
Une chambre en
ville
de Jacques Demy
(France, 1982)
Reprise en version restaurée le 9 octobre 2013
Passez un été "en chanté" avec Phil Siné !




Bien avant « Bilbo le Hobbit » au cinéma, il y a eu « Guilbaud le
gréviste » devant la caméra de Jacques Demy… « Une chambre en ville », mettant en scène le métallurgiste François Guilbaud en pleine grève sur les chantiers navals de Nantes en 1955, reste sans
doute le film le plus sombre de son auteur, à la fois une très grande réussite artistique et un échec public parfaitement injuste dans les salles (les spectateurs lui ont préféré « L’as des as »,
sorti la même semaine et bénéficiant d’une campagne médiatique et publicitaire bien plus importante, ce dont certains critiques cinéphiles – notamment à « Libération » et à « Télérama » – se sont
émus à l’époque, tentant de faire ce qu’ils pouvaient pour attirer l’attention sur le film de Demy). Le projet avait en tout cas quelque chose de fort pour le cinéaste, l’action du film se
situant là où il a grandi et son scénario – l’un des premiers auxquels il a pensé – ayant été entrepris dès les années 50 au moment des manifestations ouvrières… Le réalisateur dira d’ailleurs
lui-même d’« Une chambre en ville » : « Il y a peu de films que j’ai voulus comme celui-ci. Peu de films que j’ai rêvés comme celui-ci ». Autant dire que le long métrage demeure un élément clé de
la carrière de Demy, si ce n’est l’une de ses pièces maîtresses, injustement maudite et boudée.
Dès la scène d’ouverture, le film nous plonge dans une atmosphère d’affrontements tendus entre des manifestants et des policiers, et montre un engagement fort du côté des ouvriers de la part de
Jacques Demy. La solidarité ouvrière est joliment décrite à travers cette façon dont le peuple fait masse, d’un seul bloc contre les forces de l’ordre, pour « défendre ses droits », comme il le
clame en chantant… Les chansons trouvent ici une valeur de slogans syndicaux, parfois même assez violents à l’égard des hommes en uniformes (« Police milice ! Flicaille racaille ! » scande-t-on
alors avec conviction et détermination). Les relations qui se nouent entre les ouvriers sont aussi importantes dans le déroulement du récit (on découvre François souvent entouré de ses «
camarades »), mais la force politique du film est toujours mis en relation avec une histoire d’amour qui se révèle au fond tout aussi brûlante et violente que les échauffourées avec la flicaille
! Jacques Demy ne se refait donc qu’à moitié, ayant toujours besoin de se raccrocher à la force vive de son cinéma : la fureur des sentiments… Guilbaud tombe ainsi amoureux d’Edith, une femme
mariée mais qui se prostitue par dépit (son mari est impuissant), alors qu’il est en couple avec Violette, qu’il aime bien mais avec qui il ne se voit pas vivre…
« Une chambre en ville » se construit alors peu à peu comme une véritable tragédie. Tous les fils se nouent sous nos yeux impuissants, jusqu’à une issue forcément fatale… Demy ose inclure des
éléments assez violents dans son intrigue, chose assez inédite dans son cinéma : le rejet de Violette par Guilbaud alors qu’elle lui apprend qu’elle est enceinte de lui, la vengeance meurtrière
puis le suicide du mari impuissant (qui se tranche la gorge sous les yeux de sa femme !), la violence policière à l’égard des manifestants (qui coûtera finalement la vie à Guilbaud) et le coup de
revolver fatal que se porte Edith lorsqu’elle voit mourir à ses pieds son amour… Une fin de tragédie shakespearienne, si l’on peut dire, voire quasiment opératique, tant les postures que prennent
parfois les acteurs, les décors ostentatoires et la musique de Michel Colombier (Demy délaisse pour l’occasion son compositeur fétiche Michel Legrand) évoquent des compositions d’Opéra ! Une
violence qui accompagne en outre une crudité générale très prégnante, qui ajoute à l’atmosphère sombre et sans détour du film : on le voit notamment à la nudité frontale d’Edith (entièrement nue
sous son manteau de vison) et au vocabulaire très prosaïque employé par les personnages (« J’en ai rien à foutre », « saloperie », « tu fais la pute », ou encore l’irrésistible et culte « Tu me
prends vraiment pour une conne » de Danielle Darrieux).
Jacques Demy reprend au fond la méthode utilisée sur « Les parapluies de
Cherbourg », mais en la poussant cette fois-ci à son apogée : « Une chambre en ville » est ainsi lui aussi intégralement « chanté », en maintenant un niveau de langage familier, transformant
ainsi les conversations populaires en art véritable… Cela ne l’empêche d’ailleurs pas de se permettre quelques notes d’humour : « Ca pue le poulet » entend-t-on pour décrire la rue pleine de
policiers, « Vas donc au piquet mon amour » dira gentiment Violette à François, qui doit retourner au « piquet de grève », et un peu plus loin « Alors tu n’es pas une vraie pute » s’étonne
François en se réveillant au matin avec Edith, qui lui déclame en souriant « Je ne travaille qu’à mi-temps » !
Et pour nous accompagner dans cette fabuleuse « tragédie en chanté » et nous conter combien la vie est une lutte permanente et peut-être sans espoir, autant dans le monde du travail qu’en amour,
les acteurs d’« Une chambre en ville » sont tous au diapason ! Si Catherine Deneuve et Gérard Depardieu n’apparaissent finalement pas au casting suite à un désaccord artistique avec le
réalisateur (ceux-ci voulaient chanter eux-mêmes leurs textes, ce que Demy refusait fermement), leur remplacement par les acteurs moins « installés » Richard Berry (encore débutant) et Dominique
Sanda dans les rôles principaux s’est peut-être au fond révélé payant (pas pour faire des entrées certes !), dans la mesure où le cinéaste s’est peut-être senti bien plus libre d’aller au bout de
ses désirs, avec des comédiens alors plus ouverts à la prise de risque… Quant aux seconds rôles, ils étonnent autant qu’ils impressionnent : Danielle Darrieux en vieille bourgeoise solitaire qui
hait les bourgeois, Michel Piccoli en mari jaloux et violent, Jean-François Stévenin en ouvrier bon bougre… Une distribution de rêve pour un film inoubliable à (re)voir absolument !
Autres films de Jacques Demy :
- Les Parapluies de Cherbourg
- Les demoiselles de Rochefort
- Peau d’âne
- Trois places pour le 26
 [Les pépites de
[Les pépites de![]()
![]()

![]()
![]()
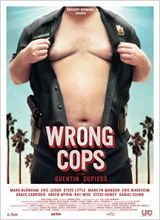
![]()
![]()


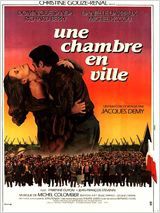
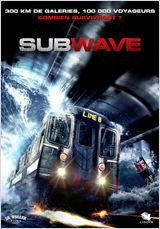



 musicalement, le cinéma est également le lieu de la création d'une nouvelle musique classique qui, se démarquant du courant moderniste et parfois un peu complexe à suivre quand l'on n'a
musicalement, le cinéma est également le lieu de la création d'une nouvelle musique classique qui, se démarquant du courant moderniste et parfois un peu complexe à suivre quand l'on n'a
