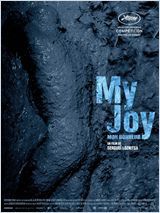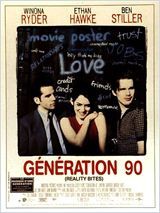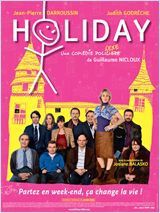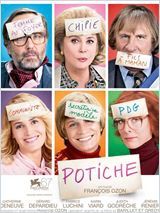Note :![]()
![]()
Avis aux amateurs de gros nanars bien pourraves, « Mega Piranha » a été fait pour vous ! « Fait pour vous » au sens littéral du terme d’ailleurs : le film a été pensé, produit et réalisé pour
devenir un navet décérébré tout pourri, lorgnant sans cesse un peu plus vers la série Z et au-delà… Fauché jusqu’à l’arrête (de piranha, donc) et écrit avec les pieds (ou peut-être les nageoires,
qui sait ?), « Mega Piranha » vient trouver une place de choix au beau milieu des multiples productions du studio américain « The Asylum », spécialisé dans les sous-sous-productions, à qui l’on
doit notamment des chefs-d’œuvre du n’importe nawak, tel « Mega Shark vs Giant Octopus», « Titanic 2 » ou « Moby Dick 2010 » pour le plus récent ! Bien sûr, le principe du nanar volontaire recèle
mois de spontanéité et de fraîcheur qu’une daube malgré elle, mais il n’en devient finalement que plus drôle encore, puisque tout y est appuyé jusqu’à l’éclate totale !
Jugez plutôt : surfant sur le revival du piranha mangeur d’homme, remis au goût du
jour avec le récent remake en 3D d’Aja, « Mega Piranha » n’hésite pas à enfoncer le clou et à aller toujours plus loin dans l’« énormissime », puisque les poissons sont ici géants ! (Eh oui,
le « Mega » du titre n’a rien d’une imposture…) Ce n’est donc pas du piranha de pédé pour aquariophiles que l’on vous sert ici, mais bel et bien du piranha démesuré, capable de s’enfiler un
humain en une bouchée, voire même un destroyer ou un sous-marin nucléaire qui passait par là, tant qu’à faire… Le principe du film est d’ailleurs imparable : au fil du récit, les piranhas
deviennent de plus en plus mégas, à l’image même du long métrage, qui devient lui aussi de plus en plus gros et gras, ne reculant devant aucun ridicule, ni aucune connerie grosse comme un « Mega
Piranha » ! Si vous aimez les répliques qui tâchent, les acteurs médiocres, les accumulations monstrueuses de clichés éculés du film catastrophe, et même pourquoi pas les bimbos stupides à gros
nichons (formidable séquence d’ouverture !), vous allez être servi… La fin sur fond de coucher de soleil et de romance improbable entre le « musclor » du film (aka Paul Logan !) et la
scientifique (appelez-la juste « Tiffany »), est encore à hurler de rire, malgré tous les fous rires qui auront déjà pu précéder !
Côté intrigue (parce qu’il y en a une, en plus !), si le film démarre sur un vague sous-texte politique, laissant présager un conflit entre les Etats-Unis et le Venezuela, on sent que tout se
resserre par la suite sur un fond écologique des plus ambigu… Si les piranhas sont « mégas » et grossissent d’heure en heure, c’est forcément à cause d’une expérience scientifique qui a mal
tournée… Sauf que cette expérience avait à la base une vocation environnementaliste, pour sauvegarder l’écosystème ! Il ne faut probablement pas surinterpréter un film pareil, mais quand on
entend la pseudo écolo scientifique vanter la puissance des mégatonnes nucléaires en pleine mer pour éliminer les poissons carnassiers, on manque quand même de s’étrangler… Allez, on s’en fout,
et on profite avant tout du spectacle ! Ouch, le héros qui envoie valdinguer la poiscaille à bons coups de pieds dans la gueule… Aah, les incrustations d’images de piranhas dans les plans qu’on
dirait commises par un enfant de 2 ans… Ooh, les piranhas volants qui attaquent les terres et se mettent à dévorer des immeubles… C’est juste complètement délirant et carrément bandant !
- Piranha 3D, d’Alexandre Aja (Etats-Unis, 2010)