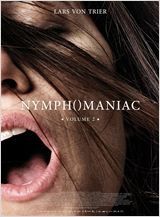Qu’un film sorte avec un visa d’exploitation
agrémenté d’une interdiction aux moins de 12, 16 ou 18 ans est une chose, certes, parfois discutable. Mais que ce visa soit modifié au cours de l’exploitation du film en salles par un tribunal,
suite à la plainte d’une association ultra-catho et conservatrice, est, il me semble, un peu inquiétant quant au climat réactionnaire qui ronge peu à peu notre société et la fait retourner
progressivement dans l’obscurantisme…
Si le système d’attribution des visas demeure très probablement imparfait et n’évite certainement pas la corruption par les studios les plus fortunés prêts à tout pour permettre à leurs films,
quel que soit leur degré de violence, d’être vus par le plus grand nombre, l’affaire « Nymphomaniac » révèle tout de même des aspects peu rassurants quant à la conception de progrès social ou
moral dans la France d’aujourd’hui… Il est vrai que la vraie fausse polémique autour du film de Lars von Trier à sa sortie n’était pas des plus subtiles et que sa façon de se « vendre » comme un
objet de pornographie « grand public » (ce qu’il n’est finalement en aucune façon !) relevait visiblement plus d’un opportuniste mercantilisme que d’un pur amour de l’art… « art » que glorifie
pourtant chaque image du long métrage, immense film d’auteur que l’on ne manquera pas de qualifier de chef-d’œuvre, même si ce n’est pas forcément le propos de ces quelques lignes de colère…
Il faut dire que l’association Promouvoir, à l’origine de la requête de révision du visa (rehaussant l’interdiction de 12 à 16 ans pour le volume 1 de « Nymphomaniac » et de 16 à 18 ans pour le
volume 2), n’en est pas à son coup d’essai. Association se targuant de faire la « promotion des valeurs judéo-chrétiennes, dans tous les domaines de la vie sociale », Promouvoir a déjà tenté
d’interdire « Antichrist » (un autre film de Lars von Trier, comme par hasard !) aux moins de 18 ans, en vain d’ailleurs, même si leur plainte avait fini par retarder la sortie du film dans les
salles… Ce groupuscule réputé homophobe et proche de l’extrême droite (ça fait envie, non ?) était à l’origine de la création de l’interdiction aux mineurs pour un film qui ne soit pas
pornographique, lors de l’affaire « Baise-moi », le film de Virginie Despentes qui avait tenu à peine quelques jours en salles avec une interdiction aux moins de 16 ans avant d’être retiré de
l’affiche, temporairement purement et simplement interdit… Sans compter que d’autres films encore ont fait les frais de Promouvoir, comme notamment le « Ken Park » de Larry Clark.
Sur le site internet de l’association, on trouve notamment ce texte mémorable : « La pornographie représente un danger capital pour la jeunesse. Elle déforme en effet de manière grossière et
racoleuse la réalité de l’union charnelle, en donne une image fausse, et peut aboutir au résultat exactement inverse de celui recherché par ceux qui s’y adonnent : l’impuissance amoureuse, avant
que la recherche de la violence ne vienne « compenser » ce phénomène dévastateur. Le caractère artificiel des relations qui en découle décourage un nombre croissant de jeunes gens, avec un dégoût
pour le sexe opposé qui conduit tout droit à l’homosexualité, masculine ou féminine, dont il est l’un des agents déclencheurs». Bon, ça, c’est juste pour vous les situer un peu mieux… bien qu’il
soit apparemment extrêmement difficile d’en savoir plus sur ce charmant collectif !
Pour en revenir à « Nymphomaniac », il est assez clair que la décision prise par le tribunal est tout bonnement inique et insultante pour la liberté. Les raisons exprimées dans l’ordonnance
demeurent d’ailleurs assez souvent floues et fallacieuses, sujettes à une subjectivité extrême : "des scènes de sexe montrées avec un certain réalisme" (ça c’est « certain » !), "[le film] se
déroule dans un climat d'ensemble assez sombre" (sans blague ?), "l'utilisation de la sexualité à des fins de manipulation" (manipulation de qui ? pourquoi ?), "le film présente de nombreux gros
plans de sexes féminins et masculins, à l'état flaccide et en érection, notamment dans une scène évoquant la pédophilie pour l'une et le triolisme pour l'autre" (et voilà que la pédophilie et la
partouse sont mis sur le même plan, dans une société bien pensante où une sexualité libre ne peut pas être admise en dehors d’un schéma purement judéo-chrétien du couple marié)…
S’il faut très certainement admettre que le film de Lars von Trier ne s’adresse clairement pas à des mineurs (et ne les passionnera d’ailleurs guère pour la plupart), une interdiction au moins de
18 ans est un risque important dans son exploitation. Il se trouve que les salles qui programmaient le film ne l’on apparemment pas retiré de l’affiche pour autant, comprenant que les mineurs
n’étaient pas vraiment le public cible du long métrage. Cependant, une telle interdiction aurait pu être fatale à un film moins réputé, dont le nombre de copies aurait forcément été revu à la
baisse au regard d’un public potentiel forcément plus réduit… Mais la carrière d’un film ne se limitant largement plus, de nos jours, à sa distribution au cinéma, la question du devenir de «
Nymphomaniac » demeure bel et bien posée : quid, notamment, de ses futurs passages à la télévision, sachant que les films pour adultes ne peuvent y être diffusés qu’entre minuit et 5h du matin et
uniquement sur certaines chaînes accessibles par abonnement et permettant un système de verrouillage de leurs programmes afin d’éviter que des mineurs y aient accès…
A ne rater sous aucun prétexte :
- Nymphomaniac : Volume 1, de Lars von Trier
- Nymphomaniac : Volume 2, de Lars von Trier

![]()