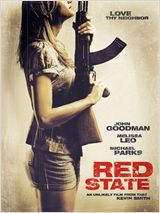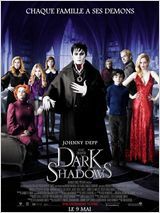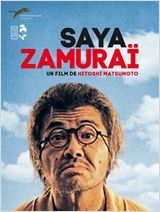(Grande-Bretagne, 2011)
Sortie le 9 mai 2012
![]()
![]()
Madonna a toujours le chic pour trouver des titres emblématiques et pertinents pour ses films, qu’il s’agisse par exemple de son premier film comme réalisatrice (maintenant l’équilibre entre «
Obscénité et Vertu ») ou un documentaire dans lequel elle s’est beaucoup investi (la
formule « I am because We are » rappelant joliment que nous ne sommes rien sans les autres). Pour sa seconde mise en scène, elle transforme les initiales de ses héros prestigieux, le roi Edouard
VIII et sa « roturière » de femme Wallis Simpson, en pronom de la deuxième personne du pluriel « WE »… car quoi de mieux après tout que le « Nous » pour conjuguer les relations amoureuses qu’elle
décrit à l’écran ?
Bien plus que les évènements historiques qu’elle évoque, il saute aux yeux que c’est avant tout la relation sentimentale de ce roi qui a du abdiquer par amour qui intéresse Madonna ! Sa mise en
perspective avec la situation de Wally Winthrop, une jeune femme malheureuse dans son mariage à New York en 1998, confirme cette obsession romantique : Wally se rend tous les jours à la vente aux
enchères des objets ayant appartenu à ceux que l’on a fini par appeler le Duc et la Duchesse de Windsor, cherchant dans les bijoux, les vêtements ou les meubles exposés comme autant de symboles
d’un conte de fées pour jeunes filles rêveuses, de celles qui veulent encore croire à l’amour malgré le mauvais tour que la vie leur joue… Sa relation naissante avec un bel agent de sécurité de
chez Sotheby’s, où se déroule la vente, va peu à peu remettre sa vie en perspective, en même temps que sa vision de l’histoire d’amour de Wallis et Edouard va évoluer… Une vision des plus
féministes, inversant les perspectives sur le couple déchu : car si l’on parle souvent de ce à quoi Edouard a du renoncer (la royauté), on ne pense jamais aux sacrifices que Wallis a de son côté
du consentir !
Oscillant subtilement entre les deux époques, le film de Madonna révèle avant tout une immense intelligence de la mise en scène ! Si l’on ressent de multiples influences et emprunts, il se dégage
pourtant de « W.E. » un vrai style visuel, confirmant une profonde affinité et une certaine personnalité de la chanteuse pour manier la caméra ! Ce n’est pas encore tout à fait le chef-d’œuvre
immortel que la star voudrait certainement nous livrer un jour (il est amusant, d’ailleurs, d’entendre le titre « Masterpiece », issu de son nouvel album, pendant le générique de fin), mais c’est
un nouveau jalon sur la voie de la consécration : on est bluffé par ses multiples audaces et tentatives assez réussies de donner corps à son scénario… Madonna a un vrai talent pour filmer les
différents passages de son film, s’adaptant à chaque élément de l’intrigue : le drame, l’amour, les remous de l’Histoire, la turpitude psychologique… L’apprenti cinéaste nous emporte avec
ravissement dans un tourbillon audiovisuel étourdissant, mêlant les images d’archives à ses propres images tournées en 8, 16 ou 35 millimètres en fonction des époques ou des circonstances, joli
et efficace procédé de mise en scène… Le film livre également une superbe bande son alternant le classique et le moderne, les tubes « vintage » (on s’amuse d’y entendre notamment la voix de
Roberto Alagna entonner « Salade de fruits »…) et les musiques planantes du compositeur Abel Korzeniowski. Si « W.E. » peut parfois souffrir d’une certaine confusion visuelle, on demeure pourtant
convaincu par sa belle conviction formelle et sa merveilleuse croyance dans les contes de fées, même si ces contes-là possèdent quelques circonvolutions plus trashs et typiquement « madonnesques
»… Alors oui, je le dis bien haut : « I love WE ! »
Perspectives :
- Obscénité et vertu, de Madonna
- Recherche Susan désespérément, de Susan Seidelman
- I'm Going to Tell You a Secret, de Jonas Åkerlund
- Drowned World Tour, de Madonna (vu par E.V.)