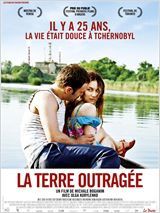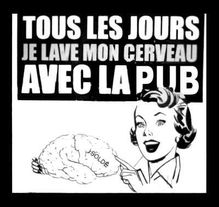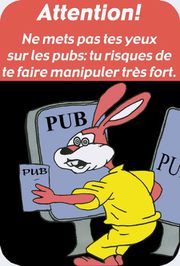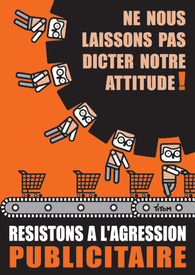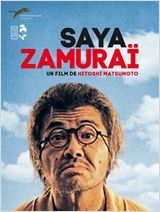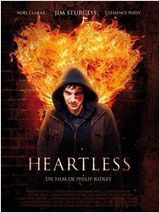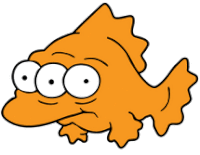(France, Espagne,
2011)
Sortie le 21 mars 2012
![]()
![]()
R.C., pongiste et écrivain, nous fait l'honneur de livrer sa critique des "Adieux à la reine", en exclusivité pour Phil Siné...
Peinture crédible de la vie à Versailles un certain été 1789, au cours des quelques jours où tout a basculé, "Les adieux à la reine" ressemble à peu près au film qu'aurait réalisé Sofia Coppola
si elle avait été française et si elle avait eu le bon goût de nous épargner ses caprices de petite fille "hype". On peut s'amuser à comparer les deux films. Coppola se doit, pour son public,
d'installer plus de repères et de rappels biographiques. Jacquot laisse les blancs en jouant sur le savoir des spectateurs. Un seul mot (« Bastille ») sonne pour nous comme un couperet
et installe une idée de fatalité, car l'Histoire est déjà écrite. Les personnages, quant à eux, ne la connaisse pas ; les voir apprendre, comprendre, interpréter puis s'affoler crée un effet de
dissonance tragique garanti. On a l'impression lorsque la reine fait ses préparatifs qu'elle va réellement prendre la fuite, et on tremble avec elle favorisé par l'unité de temps et d'action.
Mais il n'est pas question de regrets ou de ce qui aurait pu être. On ne verra pas ici ce plan ridicule et déplacé (mais c'était avant la crise...) d'un beau lustre qui pendouille et du saccage
de toutes ces beautés raffinées, macarons et jolies chaussures, quel gâchis...!
Le Versailles de Jacquot est absolument inédit pour trois raisons. D'abord, il n'est pas statique. J'ai parlé d'unité de temps et d'action, il y a aussi unité de lieu et de vision, mais ça ne
ressemble en rien à du théâtre. L'idée de mouvement est ce qui motive le film, les personnages étant lancés comme des flèches, l'arc étant la prise de la Bastille. Guitry et Rossellini filmaient
Versailles en plan fixe, Coppola syncopait son montage en copiant Malick, la caméra de Jacquot systématise l'utilisation du panoramique zoomé (le plus souvent en fait, un zoom
« déviant » latéralement en panoramique). L'effet est étrange et même inquiétant car il rend le mouvement fluide et pourtant instable. Le cadrage qui ponctue ce genre d'effet est
fatalement un gros plan. Dieu sait que je déteste les gros plans, on dirait du crachat de visage sur l'écran, mais ici, un peu comme chez Dreyer, ça fonctionne plutôt bien grâce aux enchaînements
du montage. On peut avoir l'impression que la caméra cherche à sonder quelque chose sans y parvenir (vous le dites si c'est de la branlette, ma critique...), cela offre surtout une sensation de
cauchemar, le cadrage, les visages, le point de vue, tout se déforme en permanence. La monarchie perd sa forme fixe, celle qui est la sienne depuis des siècles. En cours de route, la majesté de
la reine s'effiloche, elle devient de plus en plus monstrueuse.
Un autre point remarquable du Versailles de Jacquot est qu'il ne se borne pas aux personnages historiques. Les servants sont composés avec le même soin que leurs maîtres. Cela permet de
multiplier les angles de vue. On ne s'identifie pas seulement à la reine (laquelle était identifiée à Coppola elle-même dans son "Marie-Antoinette"), ni même à notre guide, Sidonie Laborde, qui
est plus une sorte de moteur (la pointe de la flèche en quelque sorte), mais il se crée une mosaïque de points de vue, qui va de l'admiration au dégoût, et cela sans faire intervenir celui des
révolutionnaires. Jacquot a une distance juste par rapport à ça : neutre, réaliste, sans artifice.
Le dernier point inédit, comme on l'a vu, est cette idée de filmer un Versailles moins fastueux, moins riche que dans les clichés, nous montrant un peu l'envers du décors. Il n'y est même plus
question de la destruction du beau (pas de lustre qui pendouille, donc), mais de la remontée du sale, à l'image de cette double apparition d'un rat. L'amie de Sidonie lui demande si elle n'a rien
oublié et elle sort de derrière son dos un gros rat par la queue. Il y a l'un de ces zooms dont on a parlé et qu'on pourrait ici qualifier de « maléfique », comme dans les films
d'horreur. Peu après, Sidonie navigue calmement sur le canal quand sa main accroche un rat mort flottant sur l'eau. Les égouts semblent remonter à la surface, les dorures décrépissent, l'eau de
l'étang croupit, il y a des moustiques, des piqûres. Et ces couloirs sombres qui ressemblent à des souterrains... Ça grouille de vie, en particulier au cours de cette fameuse séquence de la nuit
blanche filmée quasiment d'une traite. Les gens y sont assimilés aux rats du début, pris par la panique et par l'envie de quitter le navire. L'unité de temps crée alors un effet de fin du monde.
L'unité de la vision renvoie à ce que s'était essayé Spielberg avec succès pour "La guerre des mondes" : on ne sait et on ne voit que ce que Sidonie sait ou voit, avec toutes les lacunes que cela
comporte, ce qui renforce accessoirement la terreur liée à l'inconnu. C'est cette immersion parfaitement maîtrisée qui permet aux spectateurs de ne pas prendre trop de distance par rapport aux
personnages et à ce qu'ils ressentent étant donnés les multiples points de vue envisageables.
Pour revenir à la notion de mouvement, on la retrouve tout entière dans le scénario. D'abord par l'idée obsédante d'une insurrection (on pourrait dire d'une invasion) qu'il faut fuir à tout prix.
Ensuite dans la circulation du désir (des affects en psychanalyse) : Sidonie vers la reine d'une part, la reine vers Gabrielle de Polignac d'autre part et, une fois les espoirs de Sidonie déçus,
il y a un échange de costumes (échange d'affect) très savoureux entre elle et Polignac. Les deux fuient la reine, à sa demande, mais pour des raisons symétriques. L'une l'aime trop, au point de
lui obéir bêtement et aveuglément, l'une ne l'aime pas assez, au point qu'elle obéit (peut-être) avant tout pour sauver sa peau alors que la reine devait espérer secrètement qu'elle refuse de
partir. Interpréter Polignac pour Sidonie est une façon bien sûr de devenir enfin l'objet du désir de la reine, mais c'est aussi une sorte de vengeance inavouée et de sacrifice. L'art des
actrices est de nous faire sentir tous ces éléments contradictoires ou ambigus : Léa Seydoux, dont il me semblait jusqu'à présent qu'elle faisait tout le temps la gueule dans ses films, me paraît
ici plus nuancée. Elle est crédible pour l'époque, moderne quand il le faut, elle porte en elle l'élan fanatique qui va vers la reine, on la sent heureuse quand elle l'approche, malheureuse quand
elle croit ne pas faire ce qu'il faut. Amoureuse, chaste. Tous les romans d'initiation semblent se lire sur son visage. Et c'est un rôle d'autant plus complexe qu'il n'existe que tourné vers un
autre personnage. Le rôle de Marie-Antoinette est complexe pour la même raison (et même doublement complexe : elle existe à travers Sidonie mais se tourne exclusivement vers la duchesse de
Polignac), mais aussi parce que c'est un personnage historique. Diane Kruger compose tout simplement la meilleure version de Marie-Antoinette qu'il m'ait été donné de voir au cinéma. L'accent
autrichien est parfait, ainsi que la douceur, le côté enfantin, l'aspect déterminé, voire impérieux, les caprices et cette manière de prêter une attention délicate aux gens et aux choses pour les
oublier l'instant d'après. La voix est toujours bien placée, les mouvements, le maintien sont ceux qu'on attend vraisemblablement d'une reine dans son intimité. Vous allez penser que je suis
amoureux mais c'est une actrice décidément toujours juste, à qui il est temps de rendre hommage.
Maintenant que j'y pense, je me rappelle que si "Marie-Antoinette" possédait une grande qualité, elle se situait au niveau du son. Je ne parle pas de la musique et encore moins des dialogues
(parfois anglais, parfois français, on ne sait pas trop pourquoi) mais plutôt de ces étoffes de voix, ces chuchotements, messes basses, rumeurs, brouhahas au milieu des salons, des apparats et
des scènes de repas. Chez Jacquot, il y a cette même bonne idée de mise en scène, sauf que chez lui l'enjeu est plus esthétique que dramatique. La rumeur en soi importe peu, c'est sa propagation
qui compte, c'est à dire, encore une fois, le mouvement. Entre les personnages, et de l'extérieur à l'intérieur du château, quelque chose arrive, en douceur d'abord, sur le creux de l'oreille (on
entend à peine ce que la baronne de je-sais-plus-quoi confie à l'oreille de Sidonie au sujet de la Bastille, elle-même lui fait répéter), puis brutalement ensuite, provoquant une vraie confusion,
un chaos. L'utilisation de la musique va dans le même sens : aucune le premier jour, puis quasi continue par la suite, elle reste discrète, parfois dissonante, elle scande, porte ou accompagne
l'élan de la nuit blanche en particulier. Au dernier écho, Sidonie et la comtesse de Polignac, qui ont échangé leur rôle (c'est à ce prix que l'aristocratie peut sortir du château) rejoignent le
peuple. Sidonie, inconsciente du danger, le provoque d'abord ; mais à la toute fin, lorsque la porte de la calèche est ouverte, elle voit, et nous voyons avec elle, le vrai visage de la
Révolution. Ce qui n'était qu'un souffle jusqu'à présent prend corps. La toute fin du film voit la noblesse disparaître, sans regret ni pathos, sans enthousiasme non plus ; elle s'est simplement
disloquée d'elle-même, dans son mouvement propre (l'arrestation attendue n'a même pas lieu ; il n'y a d'ailleurs pas, ou peu, d'action directe montrée dans le film allant des révolutionnaires à
la monarchie : pas d'agression, pas de tête coupée, seulement le présage que cela arrivera, notamment par le biais d'une liste « terrifiante »). Le plus étrange, au moment où Sidonie
disparaît, est cette voix fantomatique : « Je me nomme Sidonie Laborde, je suis lectrice de la reine... » qui la rend à la fois plus vivante (on en apprend plus sur elle en deux phrases
que dans le reste du film) et en même temps sonne comme une épitaphe. Se met-elle à exister en tant que personne tandis que son rôle de lectrice auprès de la reine disparaît ? Toujours est-il que
cette voix off choque l'oreille car ce genre de discours arrive en général au début du film (elle apparaît dans la bande annonce et j'étais certain que tout le film allait être raconté en
flashback, comme dans le roman d'ailleurs). Jacquot ne parle pas au passé ; les choses sont bel et bien en train de se dérouler et se poursuivent après le passage de ces personnages dits
« historiques ». C'est à mon avis une façon d'actualiser le film et mettre en avant l'idée d'un nouveau départ possible, même s'il s'agit d'un saut dans le vide (dans le néant ?
l'inconnu ? un monde meilleur fait de démocratie et d'espoir ?). Ici, et une fois encore à l'inverse de ce qu'a fait Sofia Coppola, c'est bien l'époque qui se projette à nous. Une leçon
d'Histoire, mais tournée vers l'avenir, notre avenir.
Perspective :
- Au fond des bois, de Benoît Jacquot (France, 2010)