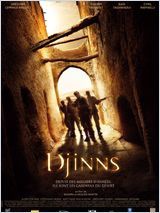Note :![]()
![]()
Malgré quelques passages un peu confus (comme souvent, cependant, dans la saga « Godzilla »), cet épisode nous propose un scénario plutôt original, cherchant visiblement à creuser de nouvelles
pistes pour ce deuxième volet de ce que beaucoup appelle la deuxième grande période de la série, inaugurée en 1984 avec « Le retour de Godzilla ». Il est question en effet du professeur
Shiragami, vivant un peu reclus après la mort de sa fille dans un attentat contre son laboratoire, qui va parvenir à fusionner les cellules d’une plante avec celles de Godzilla, prélevées sur les
ruines de Tokyo après le dernier passage du monstre… Après la peur du nucléaire dans les films réalisés pendant la guerre froide, « Godzilla contre Biollante » évoque ainsi dès 1989 ses
inquiétudes sur les manipulations génétiques, les recherches sur l’ADN, les armes bactériologiques, les OGM… Un vrai petit film visionnaire, en somme !
Le monstre issu du croisement génétique donnera donc Biollante, une sorte de grand corps immobile surmonté d’une tête de rose : image plutôt étrange et pas franchement palpitante en matière
d’action, tant Biollante demeure d’abord statique et figé, tout juste bon à communiquer avec une jeune fille télépathe pour dire qu’il est peut-être la réincarnation de la fille du professeur… Au
secours ! Sauf que lorsque Biollante se métamorphose (allez savoir pourquoi…), il se met à posséder tout un tas de tentacules à gueules de plantes carnivores qui s’agitent dans tous les sens. On
se croirait carrément face aux monstroplantes du dessin animé « Jayce et les Conquérants de la lumière » ! C’est en tout cas l’occasion parfaite de retrouver tout ce que l’on aime avec « Godzilla
» : les combats de monstres géants, incarnés par des acteurs étouffants dans des costumes de plus de 100 kilos sur les épaules ! On peut regretter un côté un peu vite expédié des combats, mais
entre-temps Godzilla ira quand même faire un petit plongeon dans l’océan, menacera de s’approcher dangereusement de quelques centrales nucléaires, se prendra les lasers inutiles d’un vaisseau
militaire volant plutôt curieux, et viendra désosser quelques immeubles en cartons d’une maquette de Tokyo… Plein de choses pour prendre son pied donc, sans compter une magnifique bande sonore :
la musique est toujours bien appuyée et bien lourdaude et a souvent l’air de parodier les grands standards hollywoodiens signés John Williams (on croit reconnaître l’air des « Dents de la mer »
ou de « Star Wars » à certains moments, et chaque apparition de Godzilla est soulignée par un thème de quatre ou cinq notes bien grasses et bien détachées, supposées créer un climat d’angoisse :
un pur régal !)
Reste que la mise en scène n’est pas toujours exaltante et que le tout manque de rythme. Si certaines sous-intrigues ennuient ou laissent carrément sceptique, on sait cependant que le réalisateur
Kazuki Omori avait deux grands rêves dans sa vie : réaliser un épisode de Godzilla et un autre de James Bond. Etant parvenu à la moitié de ses ambitions avec « Godzilla vs Biollante », il a cru
bon d’incruster dans le scénario initial toute une série d’éléments de film d’espionnage, qui évoqueraient ainsi la saga de l’agent 007… Hélas, ces passages-là sont souvent assez confus : on
comprend pourtant que plusieurs agents d’organisations internationales visiblement diverses (Etats-Unis, Moyen-Orient…) s’affrontent pour récupérer les cellules de Godzilla et ainsi créer
d’autres monstres comme Biollante, essentiellement à des fins militaires. Même si ce ne sont pas les passages les plus convaincants du film, on peut quand même leur reconnaître le mérite
d’évoquer avec philosophie la terrible nature humaine… Comme le dit magnifiquement l’un des personnages : « Le vrai monstre n’est ni Godzilla, ni Biollante, mais l’homme qui les a créés ! »
Mise en perspective :
- Godzilla vs. Mechagodzilla, de Jun Fukuda (Japon, 1974)
- Godzilla & Mothra : The battle for Earth, de Takao Okawara
(Japon, 1992)
- Godzilla vs Megalon, de Jun Fukuda (Japon, 1973)
- Gamera, le monstre géant, de Noriaki Yuasa (Japon, 1965)